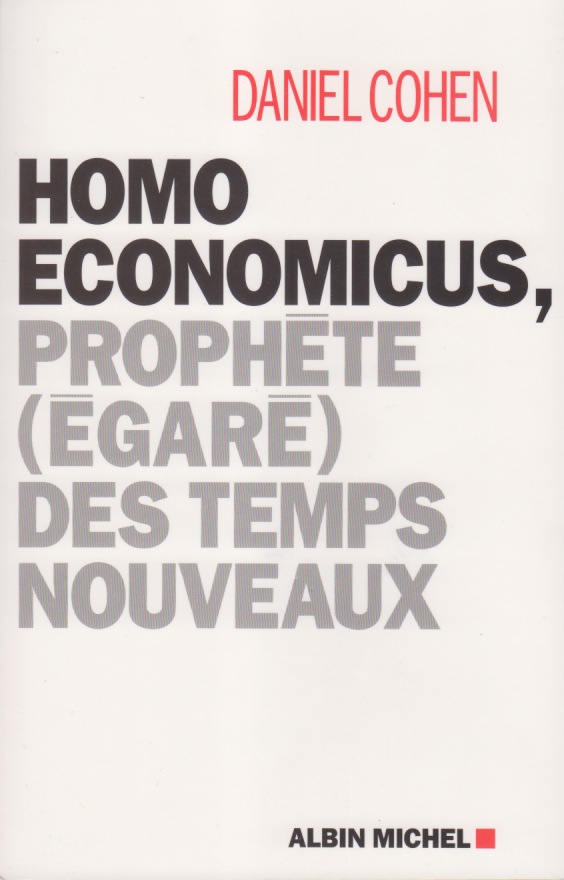Critiques de Daniel Cohen (84)
Une fois n’est pas coutume : je sors de la littérature pour me tourner vers un essai (j’en lis quelque fois) avec un besoin d’essayer de comprendre « la civilisation qui vient ».
Daniel Cohen est reconnu pour ses capacités à décrypter l’économie et pour son talent de pédagogue.
En quelques chapitres très simples, et dans une première partie intitulée ""L'illusion numérique", il revient sur des notions fondamentales, comme un rappel nécessaire sur ce qu’est l’homme – un corps et un esprit – alors que le « capitalisme de surveillance » se déploie et que »l’anomie politique » nous guette.
Il fait appel à des éléments très concrets de notre vie de tous les jours, comme la référence à la série anglaise « Back Mirror » ou à des auteurs complémentaires, comme Michel Desmurget pour son livre « La Fabrique du crétin digital ».
« L’homme numérique (...) est à la fois solitaire et nostalgique, libéral et antisystème. Il est pris dans le piège d’une société réduite à l’agrégation d’individus voulant échapper à leur isolement en constituant des communautés fictives." nous explique-t-il.
« Les hommes vivent au-dessus de leurs moyens psychiques » dit aussi le psychanalyste Pierre Legendre dans son introduction.
Daniel Cohen réussit à nous présenter la situation très paradoxale dans laquelle nous baignons actuellement. « Décrire la révolution numérique n’est pas faire le récit d’un destin annoncé ou subi » - Ouf ! – « C’est en explorer les virtualités, en mesurer les risques, pour se donner les moyens de la dominer. Là est le véritable enjeu. » Oui, mais comment ?
Joli défi donc qui passe par le rappel qu’un homme est corps et esprit, contrairement à la machine. Il nous rappelle côté esprit notre différence avec les animaux, y compris les singes, en parlant par exemple de l'immense qualité qu’à l’homme de produire de la fiction.
On pense sur ce sujet par exemple au génial « L’espèce fabulatrice » de Nancy Huston - et à notre goût commun pour la littérature entre Babeliotes ...
Mais il nous rappelle aussi que nous sommes des émotions et de l’importance du ressenti, contrairement à la machine qui n’a ni corps, ni sentiment, ni imagination. Certes l’intelligence artificielle permet à une machine d’apprendre à apprendre, et elle peut battre un champion d’échec en multipliant l’évaluation de très nombreuses combinaisons en quelques instants. Mais ces machines n’atteindront jamais le nombre de synapses et de neurones qu’utilisent le cerveau humain. Que fait-on de tout cela ?
« Quoi qu’il en soit, la révolution numérique est en marche », nous rappelle-t-il, et on ne peut plus s’y opposer. Il cite également l’excellent Bruno Patino, dont il faut lire « La Civilisation du poisson rouge » et maintenant « Tempête dans le bocal », et explique les phénomènes d’addiction aux réseaux sociaux, et l’impact sur la capacité d’attention. Il parle de Facebook, bien sûr, dont on connaît maintenant le rôle toxique sur les cerveaux, mais aussi des ravages de Tinder côté sexualité.
Un chapitre complet est consacré au « capitalisme de surveillance », dont on pourrait croire naïvement être épargné, contrairement à la Chine ou à d’autres dictatures : pas du tout, nous y sommes nous aussi – un chapitre à méditer, tout celui parle de l’ »anomie politique » et ce mouvement de fond qui balaie la société d’aujourd’hui (incapacité de réagir), alors que l’humain perd de plus en plus de valeur économique.
Quel que soit le secteur considéré, moins une firme emploie de personnels, plus elle réussit », nous explique l’économiste, ou comment Netflix ou Google peuvent doubler leur chiffre d’affaires sans personnel supplémentaires.
L’économiste Thomas Piketty l’a souvent répété : aux Etats-Unis le fléau des temps modernes est cette chute vertigineuse des revenus de la moitié inférieure de la population – qui ne pèse plus que 10% du revenu national, alors que les 1% les plus riches passent de 10 à 20 : les inégalités explosent. La France est en train d’emboiter le pas de ce grand mouvement, alors qu’on tombe dans une « anomie sociale », ou sentiment d’avoir perdu son appartenance à la société, de ne plus comprendre quel rôle on peut y jouer.
Sur le plan politique, cela a aussi des conséquences désastreuses, avec une « haine de la démocratie » qui monte dans bien des états. Au profit de la monté de la « Vox populi » ou, comme le dit Edgar Morin, « à la progression du manichéisme, des visions unilatérales, des haines et des mépris. »
Heureusement Daniel Cohen, une fois ce constat préoccupant posé, propose une seconde partie intitulée « Le retour du réel ». Il rappelle quelques principes humains, comme ce chiffre de 150 personnes comme étant le noyau dur maximum de personnes avec qui on peut interagir – n’en déplaise à Facebook. Il parle aussi de la « réciprocité » qu’aucune machine ne pourra adopter.
Et l'auteur revient sur notre passé pour mieux décrire une société de type « Horizontal/laïque » vers laquelle nous nous dirigeons. Nous sommes dans une mentalité « Postmoderne » avec l’épuisement des grands mythes, l’incrédulité, la fin de la vérité, le savoir devenu marchandise et la culture triomphant définitivement de la nature.
Est-ce si vrai ? On peut en douter, et c’est ce que fera l’auteur dans les 50 dernières pages.
Il prône tout d'abord le retour à un certain « archaïsme », comme tout ce qui peut créer de la cohésion sociale : les partis, les syndicats, ou même les entreprises. Il aimerait que la société de contrôle contemporaine se penche sur la notion environnementale – l’environnement étant le grand absent de la réflexion sur la déferlante numérique. Il aimerait qu’un service d’agences de presse renforcées puisse certifier les sites d’information. Que les appels à la haine ou au meurtre soient dument punis par la loi. Qu’il y ait plus de démocratie numérique.
« Tout a été démocratisé, l’accès au savoir, à la culture… sauf la démocratie elle-même » dit très bien Gille Mentré. Un comble ! Et ce paradoxe encore relevé, qui fait que la société numérique « fait naître une aspiration à la discussion ouverte » (on pense aux mouvements défunts « Nuit debout ») « mais s’avère incapable d’organiser la confrontation nécessaire d’idées contraires. »
Pour conclure l'auteur nous annonce que « Winter is coming ».
La crise du COVID, la Guerre en Ukraine, et surtout les risques climatiques (de mon point de vue pas suffisamment mis en lumière par l’auteur, même s’il consacre un chapitre intitulé « L’horloge climatique ») nous amène à « l’ère des catastrophes ». Si nous n’y prenons garde, nous filons tout droit vers l’effondrement. Et nous sommes tous comme les acteurs du film « Don’t look up » à se tenir dans un déni cosmique sans réagir.
Dans un monde où « cinquante concepteurs prennent des décisions pour 2 milliards de personnes », nous avons laissé filé notre liberté et se sommes livrés pieds et mains liés à un avenir dont nous ne voulons pas.
Que reste-t-il comme espoir ? Les femmes, et leur possibilité de choisir de concevoir, l’amour maternel, qui ne pourra jamais être reproduit, et des institutions qu’il faut sauver, comme celle l’université, la démocratie et enfin la capacité de l’homme à comprendre ce qui se passe - et ensuite à agir.
Un ouvrage nécessaire donc, pour trouver une voie qui nous permette d’accomplir l’utopie à laquelle la révolution numérique nous a fait rêver : celle d’un monde de liberté.
A nous de jouer.
Daniel Cohen est reconnu pour ses capacités à décrypter l’économie et pour son talent de pédagogue.
En quelques chapitres très simples, et dans une première partie intitulée ""L'illusion numérique", il revient sur des notions fondamentales, comme un rappel nécessaire sur ce qu’est l’homme – un corps et un esprit – alors que le « capitalisme de surveillance » se déploie et que »l’anomie politique » nous guette.
Il fait appel à des éléments très concrets de notre vie de tous les jours, comme la référence à la série anglaise « Back Mirror » ou à des auteurs complémentaires, comme Michel Desmurget pour son livre « La Fabrique du crétin digital ».
« L’homme numérique (...) est à la fois solitaire et nostalgique, libéral et antisystème. Il est pris dans le piège d’une société réduite à l’agrégation d’individus voulant échapper à leur isolement en constituant des communautés fictives." nous explique-t-il.
« Les hommes vivent au-dessus de leurs moyens psychiques » dit aussi le psychanalyste Pierre Legendre dans son introduction.
Daniel Cohen réussit à nous présenter la situation très paradoxale dans laquelle nous baignons actuellement. « Décrire la révolution numérique n’est pas faire le récit d’un destin annoncé ou subi » - Ouf ! – « C’est en explorer les virtualités, en mesurer les risques, pour se donner les moyens de la dominer. Là est le véritable enjeu. » Oui, mais comment ?
Joli défi donc qui passe par le rappel qu’un homme est corps et esprit, contrairement à la machine. Il nous rappelle côté esprit notre différence avec les animaux, y compris les singes, en parlant par exemple de l'immense qualité qu’à l’homme de produire de la fiction.
On pense sur ce sujet par exemple au génial « L’espèce fabulatrice » de Nancy Huston - et à notre goût commun pour la littérature entre Babeliotes ...
Mais il nous rappelle aussi que nous sommes des émotions et de l’importance du ressenti, contrairement à la machine qui n’a ni corps, ni sentiment, ni imagination. Certes l’intelligence artificielle permet à une machine d’apprendre à apprendre, et elle peut battre un champion d’échec en multipliant l’évaluation de très nombreuses combinaisons en quelques instants. Mais ces machines n’atteindront jamais le nombre de synapses et de neurones qu’utilisent le cerveau humain. Que fait-on de tout cela ?
« Quoi qu’il en soit, la révolution numérique est en marche », nous rappelle-t-il, et on ne peut plus s’y opposer. Il cite également l’excellent Bruno Patino, dont il faut lire « La Civilisation du poisson rouge » et maintenant « Tempête dans le bocal », et explique les phénomènes d’addiction aux réseaux sociaux, et l’impact sur la capacité d’attention. Il parle de Facebook, bien sûr, dont on connaît maintenant le rôle toxique sur les cerveaux, mais aussi des ravages de Tinder côté sexualité.
Un chapitre complet est consacré au « capitalisme de surveillance », dont on pourrait croire naïvement être épargné, contrairement à la Chine ou à d’autres dictatures : pas du tout, nous y sommes nous aussi – un chapitre à méditer, tout celui parle de l’ »anomie politique » et ce mouvement de fond qui balaie la société d’aujourd’hui (incapacité de réagir), alors que l’humain perd de plus en plus de valeur économique.
Quel que soit le secteur considéré, moins une firme emploie de personnels, plus elle réussit », nous explique l’économiste, ou comment Netflix ou Google peuvent doubler leur chiffre d’affaires sans personnel supplémentaires.
L’économiste Thomas Piketty l’a souvent répété : aux Etats-Unis le fléau des temps modernes est cette chute vertigineuse des revenus de la moitié inférieure de la population – qui ne pèse plus que 10% du revenu national, alors que les 1% les plus riches passent de 10 à 20 : les inégalités explosent. La France est en train d’emboiter le pas de ce grand mouvement, alors qu’on tombe dans une « anomie sociale », ou sentiment d’avoir perdu son appartenance à la société, de ne plus comprendre quel rôle on peut y jouer.
Sur le plan politique, cela a aussi des conséquences désastreuses, avec une « haine de la démocratie » qui monte dans bien des états. Au profit de la monté de la « Vox populi » ou, comme le dit Edgar Morin, « à la progression du manichéisme, des visions unilatérales, des haines et des mépris. »
Heureusement Daniel Cohen, une fois ce constat préoccupant posé, propose une seconde partie intitulée « Le retour du réel ». Il rappelle quelques principes humains, comme ce chiffre de 150 personnes comme étant le noyau dur maximum de personnes avec qui on peut interagir – n’en déplaise à Facebook. Il parle aussi de la « réciprocité » qu’aucune machine ne pourra adopter.
Et l'auteur revient sur notre passé pour mieux décrire une société de type « Horizontal/laïque » vers laquelle nous nous dirigeons. Nous sommes dans une mentalité « Postmoderne » avec l’épuisement des grands mythes, l’incrédulité, la fin de la vérité, le savoir devenu marchandise et la culture triomphant définitivement de la nature.
Est-ce si vrai ? On peut en douter, et c’est ce que fera l’auteur dans les 50 dernières pages.
Il prône tout d'abord le retour à un certain « archaïsme », comme tout ce qui peut créer de la cohésion sociale : les partis, les syndicats, ou même les entreprises. Il aimerait que la société de contrôle contemporaine se penche sur la notion environnementale – l’environnement étant le grand absent de la réflexion sur la déferlante numérique. Il aimerait qu’un service d’agences de presse renforcées puisse certifier les sites d’information. Que les appels à la haine ou au meurtre soient dument punis par la loi. Qu’il y ait plus de démocratie numérique.
« Tout a été démocratisé, l’accès au savoir, à la culture… sauf la démocratie elle-même » dit très bien Gille Mentré. Un comble ! Et ce paradoxe encore relevé, qui fait que la société numérique « fait naître une aspiration à la discussion ouverte » (on pense aux mouvements défunts « Nuit debout ») « mais s’avère incapable d’organiser la confrontation nécessaire d’idées contraires. »
Pour conclure l'auteur nous annonce que « Winter is coming ».
La crise du COVID, la Guerre en Ukraine, et surtout les risques climatiques (de mon point de vue pas suffisamment mis en lumière par l’auteur, même s’il consacre un chapitre intitulé « L’horloge climatique ») nous amène à « l’ère des catastrophes ». Si nous n’y prenons garde, nous filons tout droit vers l’effondrement. Et nous sommes tous comme les acteurs du film « Don’t look up » à se tenir dans un déni cosmique sans réagir.
Dans un monde où « cinquante concepteurs prennent des décisions pour 2 milliards de personnes », nous avons laissé filé notre liberté et se sommes livrés pieds et mains liés à un avenir dont nous ne voulons pas.
Que reste-t-il comme espoir ? Les femmes, et leur possibilité de choisir de concevoir, l’amour maternel, qui ne pourra jamais être reproduit, et des institutions qu’il faut sauver, comme celle l’université, la démocratie et enfin la capacité de l’homme à comprendre ce qui se passe - et ensuite à agir.
Un ouvrage nécessaire donc, pour trouver une voie qui nous permette d’accomplir l’utopie à laquelle la révolution numérique nous a fait rêver : celle d’un monde de liberté.
A nous de jouer.
A lire les deux autres critiques favorables sur Babelio, je me dis que je n'ai sûrement rien compris et que mes maigres connaissances en économie ne m'ont pas permis de comprendre. Car j'ai trouvé cet essai terriblement fouillis et confus. Alors oui, il y a énormément de références, mais qui alourdissent le propos. Parfois, sur plusieurs pages, l'auteur ne s'exprime qu'à travers des références, d'ailleurs parfois douteuses, comme certains films ou séries. De Levi-Strauss à Game of throne en passant par Proust, on a parfois du mal à saisir où l'auteur veut en venir, même si on comprend bien qu'il parle de l'aspect négatif du numérique sur les sociétés humaines. Oui, les jeunes générations ont beaucoup de mal à rester dans le réel. J'ai parfois l'impression d'être un égaré du XXe siècle lorsque je vois les gens au travail ou dans la rue avec leurs écouteurs greffé sur les oreilles et leur téléphone prolongeant leur main comme une prothèse. Mais je me plais à cultiver cette différence dans la mesure du possible, pour rester en contact avec la vie réelle. Alors je partage effectivement le questionnement et la mise en garde de Daniel Cohen à propos de la civilisation du numérique qui ne va d'ailleurs que s'intensifier, quoi qu'on fasse, et accroître la déshumanisation déjà à l’œuvre.
Cet essai brillant et un condensé de philosophie, de sociologie, d’économie et de psychologie.
Comment expliquer la situation de notre monde contemporain et la relation complexe et non linéaire entre le bonheur et l’argent, à travers les leçons de l’histoire, mais aussi en se servant de ce que les sciences humaines nous révèlent des comportements humains,, individuels et en groupe? L’auteur fait feu de tout bois et il n’est pas de domaine qui ne contribue par ses évolutions récentes à suggérer une explication ce que chacun peut observer pour peu que l’on soit attentif à l’actualité.
Les chapitres sont courts permettant une relecture lorsque les données sont complexes ou peu familières.
Les sources sont clairement citées et commentées, et de nombreux exemples viennent étayer les assertions.
Un bon état des lieux de l’humanité dont l’adaptabilité conditionne la survie et permet de croire encore au bonheur, même si les moyens utilisés ne sont pas les bons
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Comment expliquer la situation de notre monde contemporain et la relation complexe et non linéaire entre le bonheur et l’argent, à travers les leçons de l’histoire, mais aussi en se servant de ce que les sciences humaines nous révèlent des comportements humains,, individuels et en groupe? L’auteur fait feu de tout bois et il n’est pas de domaine qui ne contribue par ses évolutions récentes à suggérer une explication ce que chacun peut observer pour peu que l’on soit attentif à l’actualité.
Les chapitres sont courts permettant une relecture lorsque les données sont complexes ou peu familières.
Les sources sont clairement citées et commentées, et de nombreux exemples viennent étayer les assertions.
Un bon état des lieux de l’humanité dont l’adaptabilité conditionne la survie et permet de croire encore au bonheur, même si les moyens utilisés ne sont pas les bons
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Une brève histoire de l’économie sera malheureusement le dernier livre de Daniel Cohen, célèbre économiste Français disparu en août 2023 et publié ici à titre posthume.
Ce livre se veut être un condensé de l’évolution de la pensée économique de ce cher professeur, analysant les balbutiements de l’économie (l’homme primitif, l’apparition de l’agriculture) jusqu’à ses excès voir dérives actuelles (IA, écologie).
Jacques Attali s’était également intéressé à retracer l’histoire de l’économie ainsi qu’à imaginer son évolution future dans son brillant « Une brève histoire de l’avenir », titre par ailleurs très semblable à celui de Daniel Cohen.
C’est concis, accessible et même si cela ne révolutionnera pas l’économie c’est brillant et touchant de lire un écrit publié à titre posthume.
Ce livre se veut être un condensé de l’évolution de la pensée économique de ce cher professeur, analysant les balbutiements de l’économie (l’homme primitif, l’apparition de l’agriculture) jusqu’à ses excès voir dérives actuelles (IA, écologie).
Jacques Attali s’était également intéressé à retracer l’histoire de l’économie ainsi qu’à imaginer son évolution future dans son brillant « Une brève histoire de l’avenir », titre par ailleurs très semblable à celui de Daniel Cohen.
C’est concis, accessible et même si cela ne révolutionnera pas l’économie c’est brillant et touchant de lire un écrit publié à titre posthume.
A la vitesse ou les algorithmes nous fabriquent, Economistes, politiques, journalistes, écrivains, que savent ils?..Sauf a travailler pour les services de l'état écrire un livre de propagande à destination des inquiets?... Ils ne savent rien de rien..
Qui peut dire à ce jour a quoi ressemblera la société dans moins de 10 ans à part les informaticiens Googoliens et autres qui s'activent dans les couloirs du temps très court qui reste a l'humanité archaique?... Hé oui, voici le nouveau Dieu qui sait déjà tout de nous. Un Dieu qui a imposé sa puissance sans guerre ni aucune difficultés, en quelques années avec la complicité des idiots "modernes", lesquels en attendant d'être implantés n'ont plus qu'une crainte.. Perdre leur téléphone.... – oui tu, tu comprends ?...me disait une amie récemment, faut absolument que je le retrouve parce que toute ma vie est là dedans...
Terrifiant?... Vous croyez?.. Les humains volontairement serviles depuis l'origine seront sans doute heureux de l'abondance, des conforts et services nouveaux , bref satisfaits d'une vie de zombie ou un Dieu les protège 24/24, de toutes tentations d'appartenance à un quelconque groupe "d'opposition" car les derniers "rebelles" n'auront que quelques heures avant l'isolement numérique, et la chute finale....
Allez?..Haut les coeurs!.. On chante les potes?.. C'est la chuuuute finaaaaale.....Meilleur Dieu à tous . Pour nous les vieux, la fin du film est proche....Pouah!..Quel lâche je fais, mais bon, Google le sait déjà........ Ahahaha...
Qui peut dire à ce jour a quoi ressemblera la société dans moins de 10 ans à part les informaticiens Googoliens et autres qui s'activent dans les couloirs du temps très court qui reste a l'humanité archaique?... Hé oui, voici le nouveau Dieu qui sait déjà tout de nous. Un Dieu qui a imposé sa puissance sans guerre ni aucune difficultés, en quelques années avec la complicité des idiots "modernes", lesquels en attendant d'être implantés n'ont plus qu'une crainte.. Perdre leur téléphone.... – oui tu, tu comprends ?...me disait une amie récemment, faut absolument que je le retrouve parce que toute ma vie est là dedans...
Terrifiant?... Vous croyez?.. Les humains volontairement serviles depuis l'origine seront sans doute heureux de l'abondance, des conforts et services nouveaux , bref satisfaits d'une vie de zombie ou un Dieu les protège 24/24, de toutes tentations d'appartenance à un quelconque groupe "d'opposition" car les derniers "rebelles" n'auront que quelques heures avant l'isolement numérique, et la chute finale....
Allez?..Haut les coeurs!.. On chante les potes?.. C'est la chuuuute finaaaaale.....Meilleur Dieu à tous . Pour nous les vieux, la fin du film est proche....Pouah!..Quel lâche je fais, mais bon, Google le sait déjà........ Ahahaha...
Julien Bénichou est parti de rien. Par sa seule volonté et sa capacité, il a construit un empire. Seulement voilà, la voie qu'il a choisi est tendancieuse et sujette à polémique car toujours border-line. Les actes de Julien seront donc en permanence remis en question.
J'ai été commerciale pendant quelques temps. Ça n'a pas duré longtemps, je n'était pas douée, je n'avais pas l'état d'esprit requis. La première partie de ce livre m'a donc rappelé un paquet de mauvais souvenirs. Mais bons ou mauvais, ce livre a touché une corde sensible personnelle et j'ai accroché assez rapidement, même si c'était pour désapprouver. C'est étrange de voir que l'on peut aimer ce qu'on déteste.
Et puis, il y a le moment de la bascule, l'appât du gain de plus en plus fort pour Julien. Le lecteur en est témoin, il n'a pas triché. Il s'est contenté de lancer les bons hameçons aux bons endroits, et le poisson a mordu.
Je trouve que ce livre fait réfléchir. En tout cas, il m'a fait réfléchir, puisque je suis passée du dégoût à la compassion.
J'ai bien apprécié cette lecture. Merci aux éditions Librinova et à NetGalley pour ce partage.
Lien : https://www.facebook.com/Les..
J'ai été commerciale pendant quelques temps. Ça n'a pas duré longtemps, je n'était pas douée, je n'avais pas l'état d'esprit requis. La première partie de ce livre m'a donc rappelé un paquet de mauvais souvenirs. Mais bons ou mauvais, ce livre a touché une corde sensible personnelle et j'ai accroché assez rapidement, même si c'était pour désapprouver. C'est étrange de voir que l'on peut aimer ce qu'on déteste.
Et puis, il y a le moment de la bascule, l'appât du gain de plus en plus fort pour Julien. Le lecteur en est témoin, il n'a pas triché. Il s'est contenté de lancer les bons hameçons aux bons endroits, et le poisson a mordu.
Je trouve que ce livre fait réfléchir. En tout cas, il m'a fait réfléchir, puisque je suis passée du dégoût à la compassion.
J'ai bien apprécié cette lecture. Merci aux éditions Librinova et à NetGalley pour ce partage.
Lien : https://www.facebook.com/Les..
Voilà un essai bien intéressant qui dépasse le cadre de l'économie pour s'intéresser aux stratégies mises en place par les individus et les sociétés dans leur quête éperdue d'une recherche toujours accrue de plus de bonheur.
Autant le dire de suite le vers est dans le fruit dès le départ car le bonheur absolu n'existe pas. Et donc, la recherche de la maximisation du bonheur ne peut que se solder par une frustration qui ne fera que s'amplifier au plus des efforts seront déployés à atteindre un but utopique allant ainsi à l'encontre même de l'effet désiré.
A force d'avidité et de compétition effrénée des sociétés qui le composent, le système économique mondial à failli de très peu imploser en 2009, il ne serait alors resté que ruine et désolation.
Ce livre a l'intérêt de poser plein d'excellentes questions et d'ouvrir autant de pistes que de réponses. Pour ma part, je désirerais apporter comme réflexions salutaires que notre terre est un système fermé et que la loi de Lavoisier si applique pleinement : rien ne se crée, rien ne se perd : tout se transforme.
Alors pourquoi ne pas oser la collaboration comme alternative à la compétition ?
Autant le dire de suite le vers est dans le fruit dès le départ car le bonheur absolu n'existe pas. Et donc, la recherche de la maximisation du bonheur ne peut que se solder par une frustration qui ne fera que s'amplifier au plus des efforts seront déployés à atteindre un but utopique allant ainsi à l'encontre même de l'effet désiré.
A force d'avidité et de compétition effrénée des sociétés qui le composent, le système économique mondial à failli de très peu imploser en 2009, il ne serait alors resté que ruine et désolation.
Ce livre a l'intérêt de poser plein d'excellentes questions et d'ouvrir autant de pistes que de réponses. Pour ma part, je désirerais apporter comme réflexions salutaires que notre terre est un système fermé et que la loi de Lavoisier si applique pleinement : rien ne se crée, rien ne se perd : tout se transforme.
Alors pourquoi ne pas oser la collaboration comme alternative à la compétition ?
Un auteur économiste bénéficiant d’une vraie notoriété, un titre percutant, le chaland est mis en appétit. Mais très rapidement le lecteur est perplexe ; loin d’être séditieux et iconoclaste le propos devient très académique, en mode macro économie standard.
De plus, le titre conjugué à la période de publication pouvaient laisser augurer que le noyau dur des analyses concernerait la crise économique qui enflamme le monde à partir de la crise du capitalisme financier de 2008.
En réalité, cet essai est une histoire économique en mode survol stratosphérique, une sorte de « que sais je ». Le propos est clair et assez complet pour un essai de ce format, même si fatalement il est régulièrement réducteur.
Malheureusement ce livre souffre, de mon point de vue, de deux défauts majeurs, Il s’agit d’abord d’une sorte de compilation où manque un véritable fil conducteur, la simple présentation chronologique ne pouvant tenir lieu de fil d’ariane. La vision de l’histoire de l’auteur, puisqu’il ambitionne de placer cet ouvrage sur ce terrain, est absente.
L’autre défaut réside dans le fait que les analyses restent conditionnées par une vision économique standard.
A cet égard, le chapitre « la quête impossible du bonheur », ne peut pas ne pas être mentionné. Cohen fait référence à un sondage « qu’est-ce que le bonheur ? », l’auteur cite à titre principal trois réponses, la situation financière, la famille et la santé. Le chapitre comprend huit pages et Cohen se contente de commentaire style analyste sondage électoral, aucune distance analytique par rapport à ce sondage à l’évidence réducteur, aux réponses singulièrement fermées, un peu court tout de même. A défaut de pouvoir développer dans le cadre de cet ouvrage, un ou deux paragraphes pour prendre ses distances ou ouvrir la réflexion auraient été les bienvenues….Pour Cohen le bonheur a fondamentalement une base matérielle et est adossé à un besoin de se comparer aux autres. Le bonheur c’est de savoir que l’on gagne plus que son beau frère c’est bien connu…
Le lecteur peut légitimement considérer que les ressorts de la psychologie humaine sont un peu plus complexes. On ne fait pas rentrer l’histoire économique, l’histoire tout court dans des systèmes théoriques hors sol, par confort idéologique, avec un chausse pieds, en coupant ce qui dépasse parce que cela gêne
Un ouvrage intéressant mais décevant
De plus, le titre conjugué à la période de publication pouvaient laisser augurer que le noyau dur des analyses concernerait la crise économique qui enflamme le monde à partir de la crise du capitalisme financier de 2008.
En réalité, cet essai est une histoire économique en mode survol stratosphérique, une sorte de « que sais je ». Le propos est clair et assez complet pour un essai de ce format, même si fatalement il est régulièrement réducteur.
Malheureusement ce livre souffre, de mon point de vue, de deux défauts majeurs, Il s’agit d’abord d’une sorte de compilation où manque un véritable fil conducteur, la simple présentation chronologique ne pouvant tenir lieu de fil d’ariane. La vision de l’histoire de l’auteur, puisqu’il ambitionne de placer cet ouvrage sur ce terrain, est absente.
L’autre défaut réside dans le fait que les analyses restent conditionnées par une vision économique standard.
A cet égard, le chapitre « la quête impossible du bonheur », ne peut pas ne pas être mentionné. Cohen fait référence à un sondage « qu’est-ce que le bonheur ? », l’auteur cite à titre principal trois réponses, la situation financière, la famille et la santé. Le chapitre comprend huit pages et Cohen se contente de commentaire style analyste sondage électoral, aucune distance analytique par rapport à ce sondage à l’évidence réducteur, aux réponses singulièrement fermées, un peu court tout de même. A défaut de pouvoir développer dans le cadre de cet ouvrage, un ou deux paragraphes pour prendre ses distances ou ouvrir la réflexion auraient été les bienvenues….Pour Cohen le bonheur a fondamentalement une base matérielle et est adossé à un besoin de se comparer aux autres. Le bonheur c’est de savoir que l’on gagne plus que son beau frère c’est bien connu…
Le lecteur peut légitimement considérer que les ressorts de la psychologie humaine sont un peu plus complexes. On ne fait pas rentrer l’histoire économique, l’histoire tout court dans des systèmes théoriques hors sol, par confort idéologique, avec un chausse pieds, en coupant ce qui dépasse parce que cela gêne
Un ouvrage intéressant mais décevant
J’ai souvent aimé entendre Daniel Cohen, particulièrement lors des émissions animées par Karim Rissouli et Thomas Snégaroff et c’est donc avec un grand intérêt que je m’engageais dans la lecture de son dernier et ultime ouvrage.
Mais j’ai assez rapidement déchanté tant l’auteur a quelques difficultés à rester concentré sur son propos. C’est du moins l’impression qui fut la mienne. On y aborde à mon avis trop de sujets pour illustrer le délitement social, la dématérialisation des relations humaines tout comme les prouesses de l’intelligence artificielle. On y aborde les gilets jaunes, le Covid, l’amour selon Tinder, les nouveaux ghettos numériques, le déficit de concentration de nos ados, l’homophobie, la xénophobie, la politique des USA, les conduites addictives et j’en passe.
Notre économiste en chef nous fait tantôt du Jean Viard, tantôt du Serge Tisseron ou du Edgar Morin selon le sujet abordé et bien souvent j’ai eu le sentiment qu’il enfonçait quelques portes ouvertes : particulièrement sur le rapport compulsif aux nouvelles technologies, le néotribalisme ou culture de l’entre soi et la perte d’influence de l’entreprise, du parti politique ou du syndicat.
Tu n’étais pas très optimiste sur la civilisation qui vient comme on aurait pu s’en douter.
Allez, ça va pour cette fois Daniel. Repose en paix.
Challenge Multi-Défis 2024.
Mais j’ai assez rapidement déchanté tant l’auteur a quelques difficultés à rester concentré sur son propos. C’est du moins l’impression qui fut la mienne. On y aborde à mon avis trop de sujets pour illustrer le délitement social, la dématérialisation des relations humaines tout comme les prouesses de l’intelligence artificielle. On y aborde les gilets jaunes, le Covid, l’amour selon Tinder, les nouveaux ghettos numériques, le déficit de concentration de nos ados, l’homophobie, la xénophobie, la politique des USA, les conduites addictives et j’en passe.
Notre économiste en chef nous fait tantôt du Jean Viard, tantôt du Serge Tisseron ou du Edgar Morin selon le sujet abordé et bien souvent j’ai eu le sentiment qu’il enfonçait quelques portes ouvertes : particulièrement sur le rapport compulsif aux nouvelles technologies, le néotribalisme ou culture de l’entre soi et la perte d’influence de l’entreprise, du parti politique ou du syndicat.
Tu n’étais pas très optimiste sur la civilisation qui vient comme on aurait pu s’en douter.
Allez, ça va pour cette fois Daniel. Repose en paix.
Challenge Multi-Défis 2024.
Pour un livre d'économie, facile et agréable à lire. De nombreuses références, des chiffres intéressants. Je regrette cependant que la pensée de l'auteur lui-même se perde souvent, n'est aussi clairement exprimée que je le souhaiterais. Il n'y a au final que peu de mesures concrètes proposées. L'auteur soulève de grandes problématiques, les questionne mais sans vraiment y répondre. C'est peut être aussi ce qui fait la force de l'ouvrage, il nous pousse à réfléchir sur la croissance et le progrès.
A partir d'une analyse économétrique de nombreuses bases de données très sérieuses, les auteurs de cette étude proposent une grille originale de lecture de l'explosion des mouvements politiques antisystèmes, principalement en France mais aussi en Europe et aux USA : gauche radicale et droite populiste.
Comment expliquer, en particulier, l'effondrement en 2017 de la vie politique traditionnelle : à la dernière élection présidentielle française aucun des partis classiques de gauche comme de droite n'accède au second tour. Si l'instabilité économique ressentie depuis 2008 est l'une des explications de la poussée populiste, ce n'est pas la seule. On veut comprendre aussi comment la vague antisystème s'est ventilée entre gauche radicale et droite populiste, France Insoumise et Rassemblement National.
L'opposition Macron-Le Pen est une opposition "gagnants-perdants" en termes de diplômes, de revenus, d'espérance dans le progrès, d'Europe, bien différente de la traditionnelle polarisation droite-gauche. En fait, l'analyse met en lumière des clivages nouveaux, essentiellement : le niveau de la confiance interpersonnelle et en l'avenir, et le niveau de bien ou de mal-être. C'est l'élément-clé de cette étude.
La colère et la peur sont des émotions qui influencent les choix politiques : la peur active le conservatisme, la colère renforce la radicalisation. La colère explique aussi l'imperméabilité des électeurs face aux affaires judiciaires qui touchent leurs élus (différente selon les cas : Fillon,Le Pen), la colère les détourne du processus de recherche d'une juste information.
Aujourd'hui, dans la société post industrielle, ce sont donc les perdants de la nouvelle économie et de la mondialisation, dotés d'un niveau de confiance très bas envers les autres, les institutions, la représentation nationale qui trouvent dans le populisme l'expression de leur ressentiment. Ainsi en va-t-il en particulier des soutiens aux Gilets jaunes.
Le vote de classe n'est plus d'actualité mais un vote d'individus heureux ou malheureux. Les classes malheureuses sont constituées d'individus désormais isolés (tout s'est délité : la famille, le syndicat, le bistrot, la messe ou la cellule ...), défiants à l'égard d'autrui, constamment déçus par l'exercice du pouvoir, de droite comme de gauche. Ce même sentiment existe aux Etats-Unis (vote Trump), en Allemagne (AfD), en Grande-Bretagne (Brexit), en Italie… Et entre gauche radicale et droite populiste, c'est le niveau de confiance envers autrui qui fait pencher l'électeur d'un côté ou de l'autre.
Car aujourd'hui, la majorité des risques (la maladie, les catastrophes naturelles, les épidémies …) est perçue comme relevant directement de l'activité humaine et non plus comme autrefois du « destin ». Et même en France, où le système de redistribution est le plus fort, il est opaque, complexe, trop fractionné, mité par des niches fiscale … ce qui accroît la défiance et conduit donc au vote populiste.
Comme toujours, les chercheurs en sciences sociales sont très forts pour poser un diagnostic. En revanche, l'ouvrage est vraiment sec sur les solutions qui pourraient permettre de renverser cette carence de confiance et ce sentiment de mal-être qui pousse tant d'électeurs à choisir soit l'abstention soit le vote populiste.
Voici donc de nouvelles pistes d'analyse, mais un livre doté d'une typographie très serrée et de graphiques pratiquement illisibles, un ouvrage utile à tous ceux qui veulent comprendre notre vie politique … et celles de nos voisins européens.
Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..
Comment expliquer, en particulier, l'effondrement en 2017 de la vie politique traditionnelle : à la dernière élection présidentielle française aucun des partis classiques de gauche comme de droite n'accède au second tour. Si l'instabilité économique ressentie depuis 2008 est l'une des explications de la poussée populiste, ce n'est pas la seule. On veut comprendre aussi comment la vague antisystème s'est ventilée entre gauche radicale et droite populiste, France Insoumise et Rassemblement National.
L'opposition Macron-Le Pen est une opposition "gagnants-perdants" en termes de diplômes, de revenus, d'espérance dans le progrès, d'Europe, bien différente de la traditionnelle polarisation droite-gauche. En fait, l'analyse met en lumière des clivages nouveaux, essentiellement : le niveau de la confiance interpersonnelle et en l'avenir, et le niveau de bien ou de mal-être. C'est l'élément-clé de cette étude.
La colère et la peur sont des émotions qui influencent les choix politiques : la peur active le conservatisme, la colère renforce la radicalisation. La colère explique aussi l'imperméabilité des électeurs face aux affaires judiciaires qui touchent leurs élus (différente selon les cas : Fillon,Le Pen), la colère les détourne du processus de recherche d'une juste information.
Aujourd'hui, dans la société post industrielle, ce sont donc les perdants de la nouvelle économie et de la mondialisation, dotés d'un niveau de confiance très bas envers les autres, les institutions, la représentation nationale qui trouvent dans le populisme l'expression de leur ressentiment. Ainsi en va-t-il en particulier des soutiens aux Gilets jaunes.
Le vote de classe n'est plus d'actualité mais un vote d'individus heureux ou malheureux. Les classes malheureuses sont constituées d'individus désormais isolés (tout s'est délité : la famille, le syndicat, le bistrot, la messe ou la cellule ...), défiants à l'égard d'autrui, constamment déçus par l'exercice du pouvoir, de droite comme de gauche. Ce même sentiment existe aux Etats-Unis (vote Trump), en Allemagne (AfD), en Grande-Bretagne (Brexit), en Italie… Et entre gauche radicale et droite populiste, c'est le niveau de confiance envers autrui qui fait pencher l'électeur d'un côté ou de l'autre.
Car aujourd'hui, la majorité des risques (la maladie, les catastrophes naturelles, les épidémies …) est perçue comme relevant directement de l'activité humaine et non plus comme autrefois du « destin ». Et même en France, où le système de redistribution est le plus fort, il est opaque, complexe, trop fractionné, mité par des niches fiscale … ce qui accroît la défiance et conduit donc au vote populiste.
Comme toujours, les chercheurs en sciences sociales sont très forts pour poser un diagnostic. En revanche, l'ouvrage est vraiment sec sur les solutions qui pourraient permettre de renverser cette carence de confiance et ce sentiment de mal-être qui pousse tant d'électeurs à choisir soit l'abstention soit le vote populiste.
Voici donc de nouvelles pistes d'analyse, mais un livre doté d'une typographie très serrée et de graphiques pratiquement illisibles, un ouvrage utile à tous ceux qui veulent comprendre notre vie politique … et celles de nos voisins européens.
Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..
Les deux premiers ouvrages de Daniel Cohen avait fait connaître au grand public cet économiste discret et brillant. En particulier, Richesse du monde, pauvretés des nations, publié début 1997, en plein débat sur la mondialisation, proposait une réappréciation sereine de l’impact de la globalisation financière sur nos économies.
Il revient en 2000 avec un petit essai stimulant dont l’ambition n’est rien moins que de percer les clés de «nos temps modernes». Notre époque, soutient-il ironiquement, n’est pas menacée par la fin du travail. Au contraire, c’est la surcharge de travail, le «travail sans fin» que doit craindre l’individu.
Daniel Cohen analyse le malaise contemporain comme un «décalage» (p. 33) entre l’économie et la société. Il plonge ses racines dans la crise de mai 1968. En mai 1968, «les jeunes récusent le monde de leurs parents» (p. 39). Ils rejettent en bloc le système fordiste qui, en son temps, eut le mérite de faire rentrer les masses illettrées du XIXème siècle dans les usines du XXème siècle (et donc de corriger le «décalage» qu’avait fait naître la Révolution industrielle), mais qui, en déshumanisant le travail, n’offrait pas aux hommes «une signification qui les porte» (p. 39). Les baby-boomers hédonistes entendent, l’informatique aidant, imposer une organisation du travail plus libre. Avec le toyotisme, la souplesse et la polyvalence sont substituées à la spécialisation et à la hiérarchie prônées en son temps par Taylor. La révolution toyotiste répond à la fois aux progrès de la robotique qui déqualifie le travail posté et aux frustrations d’une main d’oeuvre qu’abrutissait le travail à la chaîne.
Le toyotisme explique comment le travail s’est sorti du piège productiviste que lui tendait le fordisme. Loin de prendre le travail de l’homme, la machine (l’ordinateur après la machine à tisser) a «offert à l’homme de faire plus de choses» (p. 140). Mais la plus éclatante réfutation des théories sur la «fin du travail» ne se trouve pas du côté de l’offre mais de la demande. Si le travail n’est pas condamné à disparaître, c’est non seulement parce que les robots ne remplaceront jamais tout à fait l’homme dans sa tâche de production - ou, pour reprendre la métaphore aristotélicienne, parce que la navette ne courra jamais d’elle-même sur la trame - mais surtout parce que l’homme consommateur se crée toujours de nouveaux besoins.
La thèse traditionnelle du «déversement» soutient que le travail humain, après s’être «déversé» de l’agriculture à l’industrie, puis de l’industrie aux services, est en voie de tertiarisation. Mais cette lecture est trompeuse. Daniel Cohen montre que les activités liées, directement ou indirectement, à la production d’objets matériels emploie, en 1920, comme en 1990, en France comme aux États-Unis, la même proportion de la population active. Il en va de même du secteur de l’intermédiation (commerce, banques, assurances). La grande mutation de l’emploi au XXème siècle est dans l’agriculture - qui n’emploie plus personne - et dans les services sociaux (éducation, santé) qui, épargnés par le machinisme et plébiscités par les consommateurs, deviennent les principaux pourvoyeurs d’emplois.
Pour illustrer autrement que le chômage n’est pas une fatalité qu’expliquent les progrès techniques, Daniel Cohen imagine une île déserte où seraient exilés l’ensemble des chômeurs que compte un pays. On n’imagine pas, nécessité faisant loi, que cette population oisive le reste longtemps. Chacun, utilisant ses compétences, ou développant les compétences dont la société a besoin, trouverait vite à s’employer. CQFD : le chômage n’est pas un solde, entre une offre de travail et une demande de main d’oeuvre bornée par les progrès techniques, mais le produit d’un rapport social. La seule question qui vaille est celle que pose Daniel Cohen : «qu’est-ce qui permet aux chômeurs de trouver un emploi lorsqu’ils sont séparés du reste de la société et de devoir rester inactifs lorsqu’ils sont mêlés à celui-ci ?» (p. 123).
Il revient en 2000 avec un petit essai stimulant dont l’ambition n’est rien moins que de percer les clés de «nos temps modernes». Notre époque, soutient-il ironiquement, n’est pas menacée par la fin du travail. Au contraire, c’est la surcharge de travail, le «travail sans fin» que doit craindre l’individu.
Daniel Cohen analyse le malaise contemporain comme un «décalage» (p. 33) entre l’économie et la société. Il plonge ses racines dans la crise de mai 1968. En mai 1968, «les jeunes récusent le monde de leurs parents» (p. 39). Ils rejettent en bloc le système fordiste qui, en son temps, eut le mérite de faire rentrer les masses illettrées du XIXème siècle dans les usines du XXème siècle (et donc de corriger le «décalage» qu’avait fait naître la Révolution industrielle), mais qui, en déshumanisant le travail, n’offrait pas aux hommes «une signification qui les porte» (p. 39). Les baby-boomers hédonistes entendent, l’informatique aidant, imposer une organisation du travail plus libre. Avec le toyotisme, la souplesse et la polyvalence sont substituées à la spécialisation et à la hiérarchie prônées en son temps par Taylor. La révolution toyotiste répond à la fois aux progrès de la robotique qui déqualifie le travail posté et aux frustrations d’une main d’oeuvre qu’abrutissait le travail à la chaîne.
Le toyotisme explique comment le travail s’est sorti du piège productiviste que lui tendait le fordisme. Loin de prendre le travail de l’homme, la machine (l’ordinateur après la machine à tisser) a «offert à l’homme de faire plus de choses» (p. 140). Mais la plus éclatante réfutation des théories sur la «fin du travail» ne se trouve pas du côté de l’offre mais de la demande. Si le travail n’est pas condamné à disparaître, c’est non seulement parce que les robots ne remplaceront jamais tout à fait l’homme dans sa tâche de production - ou, pour reprendre la métaphore aristotélicienne, parce que la navette ne courra jamais d’elle-même sur la trame - mais surtout parce que l’homme consommateur se crée toujours de nouveaux besoins.
La thèse traditionnelle du «déversement» soutient que le travail humain, après s’être «déversé» de l’agriculture à l’industrie, puis de l’industrie aux services, est en voie de tertiarisation. Mais cette lecture est trompeuse. Daniel Cohen montre que les activités liées, directement ou indirectement, à la production d’objets matériels emploie, en 1920, comme en 1990, en France comme aux États-Unis, la même proportion de la population active. Il en va de même du secteur de l’intermédiation (commerce, banques, assurances). La grande mutation de l’emploi au XXème siècle est dans l’agriculture - qui n’emploie plus personne - et dans les services sociaux (éducation, santé) qui, épargnés par le machinisme et plébiscités par les consommateurs, deviennent les principaux pourvoyeurs d’emplois.
Pour illustrer autrement que le chômage n’est pas une fatalité qu’expliquent les progrès techniques, Daniel Cohen imagine une île déserte où seraient exilés l’ensemble des chômeurs que compte un pays. On n’imagine pas, nécessité faisant loi, que cette population oisive le reste longtemps. Chacun, utilisant ses compétences, ou développant les compétences dont la société a besoin, trouverait vite à s’employer. CQFD : le chômage n’est pas un solde, entre une offre de travail et une demande de main d’oeuvre bornée par les progrès techniques, mais le produit d’un rapport social. La seule question qui vaille est celle que pose Daniel Cohen : «qu’est-ce qui permet aux chômeurs de trouver un emploi lorsqu’ils sont séparés du reste de la société et de devoir rester inactifs lorsqu’ils sont mêlés à celui-ci ?» (p. 123).
On prête parfois un défaut à ce genre d’essais. Il suffirait d’en lire l’introduction, la conclusion, le reste en diagonale, pour en avoir fait le tour. Deux ou trois idées-force les sous-tendraient, que leurs auteurs délaieraient de manière plus ou moins habile pour boucler les 250 pages de rigueur. Fait aggravant : ces auteurs, le plus souvent connus et interviewés en conséquence dans les médias, y révèleraient tout. Alors à quoi bon les lire si l’affaire est entendue ?
Daniel Cohen a entamé cette série qui mêle économie, philosophie, anthropologie, littérature, cinéma (liste non limitative) en 2009 avec la Prospérité du vice. Homo numericus est le cinquième opus, et il est passionnant comme l’étaient ses précédents.
Daniel Cohen a des qualités de tout premier ordre : il embrasse large, il voit loin devant parce qu’il voit loin derrière et parce qu’il voit loin autour, il lit et observe beaucoup, il vulgarise sans simplifier et tel Baudelaire établit, sur presque tout, des correspondances originales, piquantes, vraies - car il y a aussi ceci qui emporte l'affaire : il vous rend intelligent.
On peut ne pas être d'accord avec toutes les analyses et les prédictions de Daniel Cohen (il en formule peu d'ailleurs, se contentant le plus souvent de tracer des possibles) mais il faut reconnaître qu'à chaque page il est stimulant, tour à tour rassurant et inquiétant - comme l’est Yuval Noah Harari, auquel il pourrait être comparé, un Harari avec un peu de Daniel Sibony dedans.
À lire absolument.
Daniel Cohen a entamé cette série qui mêle économie, philosophie, anthropologie, littérature, cinéma (liste non limitative) en 2009 avec la Prospérité du vice. Homo numericus est le cinquième opus, et il est passionnant comme l’étaient ses précédents.
Daniel Cohen a des qualités de tout premier ordre : il embrasse large, il voit loin devant parce qu’il voit loin derrière et parce qu’il voit loin autour, il lit et observe beaucoup, il vulgarise sans simplifier et tel Baudelaire établit, sur presque tout, des correspondances originales, piquantes, vraies - car il y a aussi ceci qui emporte l'affaire : il vous rend intelligent.
On peut ne pas être d'accord avec toutes les analyses et les prédictions de Daniel Cohen (il en formule peu d'ailleurs, se contentant le plus souvent de tracer des possibles) mais il faut reconnaître qu'à chaque page il est stimulant, tour à tour rassurant et inquiétant - comme l’est Yuval Noah Harari, auquel il pourrait être comparé, un Harari avec un peu de Daniel Sibony dedans.
À lire absolument.
Un livre à lire en urgence avec les temps qui courent.
Avec une clarté et une limpidité à preuve de balles, Daniel Cohen nous apporte l éclairage nécessaire à une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons.
Serions nous les nouveaux Romains? Le déclin de notre civilisation est-elle à nos portes?
Comment en est-on arrivé là !
Ce n est pas un livre sur l appitoiement sur notre civilisation mais une prise de conscience devant les faits actuels. Sans oublier l Homo numérique qui nous a totalement enveloppé dans son séduisant manteau de l invisibilité.
A l'heure desTrump,Bolsonaro, Salvini,Orban et des lobbyistes de tous genres je reste de l avis que l'ignorance est le pire des maux, alors lisez ce petit livre qui vous donnera les clés pour lutter contre la médiocrité actuelle.
Avec une clarté et une limpidité à preuve de balles, Daniel Cohen nous apporte l éclairage nécessaire à une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons.
Serions nous les nouveaux Romains? Le déclin de notre civilisation est-elle à nos portes?
Comment en est-on arrivé là !
Ce n est pas un livre sur l appitoiement sur notre civilisation mais une prise de conscience devant les faits actuels. Sans oublier l Homo numérique qui nous a totalement enveloppé dans son séduisant manteau de l invisibilité.
A l'heure desTrump,Bolsonaro, Salvini,Orban et des lobbyistes de tous genres je reste de l avis que l'ignorance est le pire des maux, alors lisez ce petit livre qui vous donnera les clés pour lutter contre la médiocrité actuelle.
Livre brillant et instructif sur les ressorts des échanges économiques dans les sociétés au fil de l'histoire. Daniel Cohen, économiste, s'appuie sur des notions de sociologie, psychologie, voire éthologie pour tenter de dégager les grandes tendances des échanges marchants et non marchants de l'histoire récente et de l'avenir proche. Il explique notamment les différences qu'il y a entre la révolution industrielle passée, accompagnée du passage du monde paysan au monde des ouvriers et d'ingénieurs et la transition post-industrielle en cours, caractérisée par les échanges immatériels. Pourquoi cette dernière ne crée pas d'emplois, voire aggrave le chômage. D.Cohen a pris le parti d'aller rapidement au travers des différentes notions théoriques, idées philosophiques et évènements historiques, ce qui rend le livre facile à lire. J'aurais aimé qu'il aille un peu plus dans le détail dans certains cas. Ce livre échappe à l'écueil qui aurait consisté à jouer les oracles et à prédire l'avenir. Il reste judicieusement dans la description des lignes de forces et insiste sur le fait que les grands évènements de l'histoire de l'économie n'ont jamais été prévus.
Un essai qui explore les contradictions entre l'Homo economicus et l'Homo ethicus; le mode compétitif et le mode coopératif; l'individualisme et l'altruisme sociétal; la mondialisation et la régionalisation, bref un tour d'horizon et une réflexion sur notre modèle économique et postmoderne.
Les sujets abordés vont droit au but au travers d'exemples factuels sans analyse détaillée, c'est efficace mais un peu court, deux à trois pages consacrées à chaque item. Disons que pour avoir lu les trois livres de Noah Harari, je dirais que Hariri parcours les mêmes problématiques avec une réflexion et une mise en contexte plus élaborée, ça ne retire rien à l'intérêt et réflexion de Daniel Cohen.
En cette perriode de pandémie virale, il est amusant de constater la vision prémonitoire de l'auteur sur les événements que nous vivons présentement. Le chapitre intitule 'l'enfermement planetaire', apparaît comme prémonitoire, il y décrit le confinement des individus, la fermeture des frontières et la remise en cause de notre modèle economiquesuite aux conséquences d'une pandémie.
Au final, pour faire une histoire courte, cet essai est facile à lire, accessible à tous, pousse à la réflexion et fait bon ménage entre l'approche économique et philosophique de l'homo economicus, l'homo philosophicus et l'homo ethicus.
Petit bémol cependant, il n'y a aucune référence bibliographique des auteurs cités dans cet essai, c'est une lacune majeure, Amartya Sen; Paul Krugman; André Comtr Sponville, et tous les autres ne seraient pas très contents de cette omissions.
Les sujets abordés vont droit au but au travers d'exemples factuels sans analyse détaillée, c'est efficace mais un peu court, deux à trois pages consacrées à chaque item. Disons que pour avoir lu les trois livres de Noah Harari, je dirais que Hariri parcours les mêmes problématiques avec une réflexion et une mise en contexte plus élaborée, ça ne retire rien à l'intérêt et réflexion de Daniel Cohen.
En cette perriode de pandémie virale, il est amusant de constater la vision prémonitoire de l'auteur sur les événements que nous vivons présentement. Le chapitre intitule 'l'enfermement planetaire', apparaît comme prémonitoire, il y décrit le confinement des individus, la fermeture des frontières et la remise en cause de notre modèle economiquesuite aux conséquences d'une pandémie.
Au final, pour faire une histoire courte, cet essai est facile à lire, accessible à tous, pousse à la réflexion et fait bon ménage entre l'approche économique et philosophique de l'homo economicus, l'homo philosophicus et l'homo ethicus.
Petit bémol cependant, il n'y a aucune référence bibliographique des auteurs cités dans cet essai, c'est une lacune majeure, Amartya Sen; Paul Krugman; André Comtr Sponville, et tous les autres ne seraient pas très contents de cette omissions.
Un livre très intéressant sur l'histoire de notre économie...Alors il est clair qu'il faut quand même s'accrocher à certains passages qui peuvent être, dans mon cas, assez compliqué à saisir et ce, malgré les relectures et je serai un beau menteur si je vous disais avoir terminé l'ouvrage mais il n'en est rien... j'ai du capituler. Très instructif ceci étant dit.
De quoi parle ce livre ? Il est difficile de répondre à cette question tant son champ de réflexion, dans l'espace et dans le temps est large. C'est à une fascinante épopée de l'humanité que l'on est convié et cela sur seulement 200 pages. Il s'agit donc d'une grande synthèse historique (1ère partie), économique (2e partie) et sociale (3e partie). C'est un ouvrage dense et parfois ardu qui a le grand mérite d'être interdisciplinaire. Philosophie, psychanalyse, sociologie ou histoire de la technique s'y mêlent constamment. Le projet est ambitieux, mais l'auteur reste humble. Son texte est hyper-référencé, de très nombreux auteurs sont cités et plusieurs livres ont carrément droit à leur petit chapitre (Sapiens, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, La singularité est proche, Le capital). Quand on cherche une grande histoire des idées et les livres importants qui ont marqué l'évolution de la pensée, on est ravi. On a parfois l'impression de lire les notes de lecture de Daniel Cohen, mais ce dernier a un tel talent pour synthétiser les idées d'un auteur ou d'une époque, parfois en une seule phrase, que c'est vraiment un plaisir.
L'auteur d'Homo Economicus est un progressiste et son dernier ouvrage montre bien l'évolution des préoccupations humaines. Mais il est également plutôt pessimiste car le progrès apporte aussi son lot d'effets pervers. Selon Daniel Cohen, 3 grands « big-bangs » ont secoué l'homme : la révolution néolithique, la révolution industrielle et enfin la croissance forte du revenu par habitant pour les pays les plus peuplés. La révolution agricole a eu pour conséquence une explosion démographique. Mais il semblerait que celle-ci soit désormais sous contrôle grâce à la transition démographique dont la cause serait... la télévision ! En effet la petite lucarne aurait un impact majeur sur les modes de vie. Elle permettrait d'occidentaliser le monde en quelque sorte. Ce qui fût un bienfait quand il s'agissait de faire moins d'enfants risque bien d'être une catastrophe en matière d'écologie... A moins que l'inventivité de l'homme ne permette de trouver une solution à ce problème. Après tout l'agriculture a permis de stocker et d'échanger de la nourriture, l'écriture des connaissances, la monnaie des richesses et l'informatique des données. Peut-être trouverons-nous un moyen technologique pour capter ou juridique pour échanger du carbone. L'auteur propose ainsi des droits de tirages CO2 en plus des droits de tirage sociaux. Il plaide aussi pour le modèle danois, et d'une manière générale pour un changement de mentalité, un grand virage de la quantité vers la qualité.
L'auteur d'Homo Economicus est un progressiste et son dernier ouvrage montre bien l'évolution des préoccupations humaines. Mais il est également plutôt pessimiste car le progrès apporte aussi son lot d'effets pervers. Selon Daniel Cohen, 3 grands « big-bangs » ont secoué l'homme : la révolution néolithique, la révolution industrielle et enfin la croissance forte du revenu par habitant pour les pays les plus peuplés. La révolution agricole a eu pour conséquence une explosion démographique. Mais il semblerait que celle-ci soit désormais sous contrôle grâce à la transition démographique dont la cause serait... la télévision ! En effet la petite lucarne aurait un impact majeur sur les modes de vie. Elle permettrait d'occidentaliser le monde en quelque sorte. Ce qui fût un bienfait quand il s'agissait de faire moins d'enfants risque bien d'être une catastrophe en matière d'écologie... A moins que l'inventivité de l'homme ne permette de trouver une solution à ce problème. Après tout l'agriculture a permis de stocker et d'échanger de la nourriture, l'écriture des connaissances, la monnaie des richesses et l'informatique des données. Peut-être trouverons-nous un moyen technologique pour capter ou juridique pour échanger du carbone. L'auteur propose ainsi des droits de tirages CO2 en plus des droits de tirage sociaux. Il plaide aussi pour le modèle danois, et d'une manière générale pour un changement de mentalité, un grand virage de la quantité vers la qualité.
Très déçu, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ou pour le dire autrement qui trop embrasse mal étreint. Si le fonds du propos est intéressant, j'ai regretté que trop souvent Daniel Cohen sorte des sentiers non pas battus, mais qu'il maîtrise, à savoir les sentiers de l'économie. Et on retrouve un peu un pot pourri de ses fiches de lectures en philosophie, anthropologie, histoire, sociologie du numérique etc. d'une légèreté consistante. Il faut d'avantage voir ce livre comme une bibliographie renvoyant à Duflo, Piketty, Vernant, Amartya Sen etc. que comme un essai poussé. Mais outre la plume scolaire, dès qu'il quitte ses sujets de prédilection ça sent le vernis culturel et quand il y est il vulgarise trop pour atteindre une réelle épaisseur.
Une excellente lecture à contre-courant de l'orthodoxie économique néo libérale actuellement dominante. D'un style clair et accessible même à ceux qui n'ont aucune connaissance économique, cet ouvrage montre, par des exemples concrets, le caractère réductionniste de la vision aujourd'hui acceptée, non sans une certaine résignation, comme une évidence selon laquelle le comportement des individus serait toujours déterminé par une logique de gains ou d'évitement d'une sanction à caractère financier. Il montre que ce comportement intègre au contraire une dimension échappant à toute quantification financière, qui tient à une certaine recherche d'harmonie ou de bien-vivre ensemble, qui comprend notamment une part d'altruisme. Ce livre recèle une part d'espoir car il montre bien que les humains ne sont pas réductibles à une froide logique financière et court-termiste. Il suscite également la colère issue du constat que cette logique soit néanmoins dominante dans le contexte de l'actuelle mondialisation
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Daniel Cohen
Quiz
Voir plus
La littérature du XXème siècle dans tous ses états
Charmes, en 1929, est une oeuvre de :
Paul Fort
Paul Claudel
Paul Valéry
Paul Éluard
15 questions
118 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, xxème-xxième siècles
, auteur françaisCréer un quiz sur cet auteur118 lecteurs ont répondu