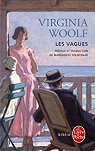Critiques de Virginia Woolf (1032)
Je ne vais pas vous mentir, Mrs Dalloway n'est pas un roman particulièrement facile à lire ni accessible si vous n'y êtes pas un minimum disposé. Il faut y mettre une certaine dose de bonne volonté, notamment si vous affectionnez l'action, car c'est très psychologique, très intériorisé, tout le contraire du mouvement.
Mais lorsqu'on accepte les règles et de jouer le jeu, de faire l'effort de rentrer dans la tête des personnages et non d'être le témoin de leurs actions, c'est vraiment une expérience littéraire de grande beauté.
Virginia Woolf développe un style bien à elle, très féminin, très subtil, qui tranche singulièrement avec l'écriture masculine de cette époque-là, sauf peut-être de celle de D. H. Lawrence, avec de nombreuses épiphores, mais dans une mouture bien à elle.
Si je devais vous décrire ce roman, je vous dirais que c'est un peu le complémentaire d'un portrait réaliste lorsque vous êtes dans un musée. Face au tableau, vous avez accès à son image à un instant donné, mais seulement à son image. Ce qu'il y a dedans, derrière la façade du regard, derrière les atours du vêtement, vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez que l'imaginer, le conjecturer.
Eh bien ici, c'est un peu comme si Virginia Woolf nous ouvrait les portes de ce mystère, comme si elle nous faisait la dissection psychologique de Mrs Dalloway, directement, certes, mais aussi en creux, par la médiation, par l'accès aux pensées d'un certain nombre de personnages qui gravitent autour d'elle.
Il est probablement temps de s'arrêter quelques instants sur le titre du roman et sur le nom du personnage principal. Mrs Dalloway, c'est-à-dire Madame Untel, sachant que le Untel est son mari, c'est-à-dire, dans l'esprit de Virginia Woolf, que le personnage, par cette appellation, est dépossédé, jusqu'à son identité même. Aux yeux de tous, elle n'est que Madame Richard Dalloway, et plus Clarissa comme elle aimait à s'entendre appeler.
Arrêtons-nous encore, si vous le voulez sur ce nom : Dalloway. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre une liste de patronymes anglo-saxons ou un vulgaire bottin pour s'apercevoir que malgré sa consonance très brittish, ce n'est pas un nom véritable, c'est une construction de l'auteure.
Dally en anglais évoque la notion de badinage ou de papillonnage. Way désigne soit le chemin, soit la manière de faire. Virginia Woolf connaissait suffisamment de français pour connaître la signification du mot dalle, comme les dalles d'un sentier tout tracé dans le parc d'une maison de campagne.
Ce titre, aussi anodin qu'il puisse paraître de prime abord, nous en apprend donc déjà beaucoup sur la perception qu'a l'auteure (et le personnage car on se rend vite compte que Clarginia Woolfoway ou Virgissa Dalloolf ne sont qu'un) sur son personnage : une femme enfermée dans une vie factice, faite d'apparences, où l'on se cache derrière un nom sans être jamais soi-même et où l'on suit des rails immuables, sans jamais pouvoir en dévier, comme lorsqu'on redoute de quitter les dalles d'un sentier de peur de se mouiller le pieds.
Finalement, la vraie vie de Clarissa, ça aura été les badinages de sa jeunesse d'où le "dally way ". Ensuite, l'incarcération dans le mariage. Mais au fait, Clarissa, dites-moi, ça ne vous évoque pas quelque chose ? Un classique de la littérature anglaise (complètement oublié de ce côté de la Manche, malheureusement. Mais oui, bien sûr, Clarissa de Samuel Richardson au XVIIIe siècle, Histoire de Clarisse Harlove dans la traduction qu'en a faite l'Abbé Prévost).
L'histoire de Clarissa (grosso modo parce que c'est un sacré pavé) raconte la résistance d'une jeune fille à un mariage d'intérêt que veut lui imposer sa famille, puis sa résistance à nouveau à accepter les avances du fourbe qui l'a enlevée pour échapper au mariage.
Clarissa Dalloway n'est donc pas, selon moi, un nom choisi au hasard, mais il est au contraire éminemment vecteur de sens, ce que l'on retrouve dans le prénom du mari : Richard comme Richardson. Si l'on ajoute à cela que le véritable mari de Virginia s'appelait Leonard, la ressemblance de consonances entre Clarissa et Richard Dalloway d'une part et Virginia et Leonard Woolf d'autre part est saisissante.
Oui, on lit beaucoup d'autobiographie cachée dans Mrs Dalloway. On y lit une volonté féministe farouche, à tout le moins, une volonté d'émancipation de la femme, enfermée dans l'étau du mariage et du qu'en dira-t-on. Le contraste est d'ailleurs particulièrement saillant avec le personnage de Sally, l'amie de jeunesse de Clarissa, dont on a peine à retenir le nom de famille, qui est toujours Sally, qu'on connaît pour elle-même et non pour sa fonction, qui se moque des convenances sociales (par exemple, elle s'invite à la réception de Clarissa sans y avoir été conviée). Elle seule semble être un personnage féminin parfaitement épanoui et à l'aise dans son costume.
Il y a aussi la folie et le suicide, deux variables éminemment liées à la personnalité de l'auteure. Elles sont véhiculées dans l'ouvrage par le personnage de Septimus. Ceci permet au passage à l'auteure de régler un peu ses comptes avec les médecins psychiatres de l'époque et qu'elle a dû subir.
En somme, vous êtes conviés à vivre une journée de cette mondaine, de cette haute bourgeoise d'une cinquantaine d'années, tout affairée à la préparation d'une réception pour le soir même. Chemin faisant, par des flash-back ou des évocations, vous pénétrez dans son intimité, dans le fond et le détail de ce qu'elle ressent et du regard qu'elle pose sur elle-même et sur les gens.
Il y a une mélancolie certaine, un sentiment d'être passée à côté de quelque chose, notamment avec son grand amour de jeunesse Peter Walsh. Mais elle l'a refusé naguère, probablement parce qu'il ne présentait pas assez bien en société, probablement parce qu'il risquait de ne pas s'élever suffisamment socialement, probablement parce qu'elle voulait elle, s'élever et briller pour avoir le sentiment d'être quelqu'un...
Elle s'aperçoit de son snobisme et le confesse volontiers. Elle a eu ce qu'elle voulait, un nom et une étiquette prestigieuse auprès d'un mari brave mais ennuyeux comme la pluie. Elle vit dans les beaux quartiers de Londres et brille de mille feux. Mais à l'heure des rides et du bilan, peut-être s'aperçoit-elle qu'elle a tout simplement oublié de vivre, oublié de vivre pour elle-même comme son ancienne camarade Sally, qu'elle retrouve avec une joie mêlée d'un gros pincement au coeur, de même que Peter, qui, après avoir erré aux Indes, est resté constamment épris de Clarissa... ô, elle qui le savait...
Bref, un roman qui m'a vraiment touchée, une introspection subtile et forte qui ne laisse pas indifférents ceux qui se sont déjà colletés à ce genre de questionnements. En outre, ce n'est ici que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : Outre la filiation que j'ai mentionnée avec la littérature du XVIIIe, on peut aussi voir une très nette filiation, au moins de coeur si ce n'est de style, avec Jane Austen. On trouve, aux environs du premier tiers du roman le passage suivant :
« Car bien entendu c'était cet après-midi-là, cet après-midi précis que Dalloway était arrivé ; et Clarissa l'appelait " Wickham " ; tout avait commencé comme ça. Quelqu'un l'avait amené ; et Clarissa avait mal compris son nom. Elle le présentait à tout le monde comme Wickham. Il finit par dire : " Je m'appelle Dalloway ! " Ce fut la première vision qu'il eut de Richard — un jeune homme blond, plutôt emprunté, assis sur une chaise longue, qui laissait échapper : " Je m'appelle Dalloway ! " Sally s'en était emparée ; et par la suite elle l'appelait toujours " Je m'appelle Dalloway ! " »
Ce passage ne peut que faire grandement penser à Orgueil Et Préjugés, où les personnages de Wickham et de Darcy seraient ici respectivement Dalloway et Walsh, mais, contrairement à l'héroïne de Jane Austen, Clarissa choisira " Wickham ", celui qui présente bien...
Mais lorsqu'on accepte les règles et de jouer le jeu, de faire l'effort de rentrer dans la tête des personnages et non d'être le témoin de leurs actions, c'est vraiment une expérience littéraire de grande beauté.
Virginia Woolf développe un style bien à elle, très féminin, très subtil, qui tranche singulièrement avec l'écriture masculine de cette époque-là, sauf peut-être de celle de D. H. Lawrence, avec de nombreuses épiphores, mais dans une mouture bien à elle.
Si je devais vous décrire ce roman, je vous dirais que c'est un peu le complémentaire d'un portrait réaliste lorsque vous êtes dans un musée. Face au tableau, vous avez accès à son image à un instant donné, mais seulement à son image. Ce qu'il y a dedans, derrière la façade du regard, derrière les atours du vêtement, vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez que l'imaginer, le conjecturer.
Eh bien ici, c'est un peu comme si Virginia Woolf nous ouvrait les portes de ce mystère, comme si elle nous faisait la dissection psychologique de Mrs Dalloway, directement, certes, mais aussi en creux, par la médiation, par l'accès aux pensées d'un certain nombre de personnages qui gravitent autour d'elle.
Il est probablement temps de s'arrêter quelques instants sur le titre du roman et sur le nom du personnage principal. Mrs Dalloway, c'est-à-dire Madame Untel, sachant que le Untel est son mari, c'est-à-dire, dans l'esprit de Virginia Woolf, que le personnage, par cette appellation, est dépossédé, jusqu'à son identité même. Aux yeux de tous, elle n'est que Madame Richard Dalloway, et plus Clarissa comme elle aimait à s'entendre appeler.
Arrêtons-nous encore, si vous le voulez sur ce nom : Dalloway. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre une liste de patronymes anglo-saxons ou un vulgaire bottin pour s'apercevoir que malgré sa consonance très brittish, ce n'est pas un nom véritable, c'est une construction de l'auteure.
Dally en anglais évoque la notion de badinage ou de papillonnage. Way désigne soit le chemin, soit la manière de faire. Virginia Woolf connaissait suffisamment de français pour connaître la signification du mot dalle, comme les dalles d'un sentier tout tracé dans le parc d'une maison de campagne.
Ce titre, aussi anodin qu'il puisse paraître de prime abord, nous en apprend donc déjà beaucoup sur la perception qu'a l'auteure (et le personnage car on se rend vite compte que Clarginia Woolfoway ou Virgissa Dalloolf ne sont qu'un) sur son personnage : une femme enfermée dans une vie factice, faite d'apparences, où l'on se cache derrière un nom sans être jamais soi-même et où l'on suit des rails immuables, sans jamais pouvoir en dévier, comme lorsqu'on redoute de quitter les dalles d'un sentier de peur de se mouiller le pieds.
Finalement, la vraie vie de Clarissa, ça aura été les badinages de sa jeunesse d'où le "dally way ". Ensuite, l'incarcération dans le mariage. Mais au fait, Clarissa, dites-moi, ça ne vous évoque pas quelque chose ? Un classique de la littérature anglaise (complètement oublié de ce côté de la Manche, malheureusement. Mais oui, bien sûr, Clarissa de Samuel Richardson au XVIIIe siècle, Histoire de Clarisse Harlove dans la traduction qu'en a faite l'Abbé Prévost).
L'histoire de Clarissa (grosso modo parce que c'est un sacré pavé) raconte la résistance d'une jeune fille à un mariage d'intérêt que veut lui imposer sa famille, puis sa résistance à nouveau à accepter les avances du fourbe qui l'a enlevée pour échapper au mariage.
Clarissa Dalloway n'est donc pas, selon moi, un nom choisi au hasard, mais il est au contraire éminemment vecteur de sens, ce que l'on retrouve dans le prénom du mari : Richard comme Richardson. Si l'on ajoute à cela que le véritable mari de Virginia s'appelait Leonard, la ressemblance de consonances entre Clarissa et Richard Dalloway d'une part et Virginia et Leonard Woolf d'autre part est saisissante.
Oui, on lit beaucoup d'autobiographie cachée dans Mrs Dalloway. On y lit une volonté féministe farouche, à tout le moins, une volonté d'émancipation de la femme, enfermée dans l'étau du mariage et du qu'en dira-t-on. Le contraste est d'ailleurs particulièrement saillant avec le personnage de Sally, l'amie de jeunesse de Clarissa, dont on a peine à retenir le nom de famille, qui est toujours Sally, qu'on connaît pour elle-même et non pour sa fonction, qui se moque des convenances sociales (par exemple, elle s'invite à la réception de Clarissa sans y avoir été conviée). Elle seule semble être un personnage féminin parfaitement épanoui et à l'aise dans son costume.
Il y a aussi la folie et le suicide, deux variables éminemment liées à la personnalité de l'auteure. Elles sont véhiculées dans l'ouvrage par le personnage de Septimus. Ceci permet au passage à l'auteure de régler un peu ses comptes avec les médecins psychiatres de l'époque et qu'elle a dû subir.
En somme, vous êtes conviés à vivre une journée de cette mondaine, de cette haute bourgeoise d'une cinquantaine d'années, tout affairée à la préparation d'une réception pour le soir même. Chemin faisant, par des flash-back ou des évocations, vous pénétrez dans son intimité, dans le fond et le détail de ce qu'elle ressent et du regard qu'elle pose sur elle-même et sur les gens.
Il y a une mélancolie certaine, un sentiment d'être passée à côté de quelque chose, notamment avec son grand amour de jeunesse Peter Walsh. Mais elle l'a refusé naguère, probablement parce qu'il ne présentait pas assez bien en société, probablement parce qu'il risquait de ne pas s'élever suffisamment socialement, probablement parce qu'elle voulait elle, s'élever et briller pour avoir le sentiment d'être quelqu'un...
Elle s'aperçoit de son snobisme et le confesse volontiers. Elle a eu ce qu'elle voulait, un nom et une étiquette prestigieuse auprès d'un mari brave mais ennuyeux comme la pluie. Elle vit dans les beaux quartiers de Londres et brille de mille feux. Mais à l'heure des rides et du bilan, peut-être s'aperçoit-elle qu'elle a tout simplement oublié de vivre, oublié de vivre pour elle-même comme son ancienne camarade Sally, qu'elle retrouve avec une joie mêlée d'un gros pincement au coeur, de même que Peter, qui, après avoir erré aux Indes, est resté constamment épris de Clarissa... ô, elle qui le savait...
Bref, un roman qui m'a vraiment touchée, une introspection subtile et forte qui ne laisse pas indifférents ceux qui se sont déjà colletés à ce genre de questionnements. En outre, ce n'est ici que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : Outre la filiation que j'ai mentionnée avec la littérature du XVIIIe, on peut aussi voir une très nette filiation, au moins de coeur si ce n'est de style, avec Jane Austen. On trouve, aux environs du premier tiers du roman le passage suivant :
« Car bien entendu c'était cet après-midi-là, cet après-midi précis que Dalloway était arrivé ; et Clarissa l'appelait " Wickham " ; tout avait commencé comme ça. Quelqu'un l'avait amené ; et Clarissa avait mal compris son nom. Elle le présentait à tout le monde comme Wickham. Il finit par dire : " Je m'appelle Dalloway ! " Ce fut la première vision qu'il eut de Richard — un jeune homme blond, plutôt emprunté, assis sur une chaise longue, qui laissait échapper : " Je m'appelle Dalloway ! " Sally s'en était emparée ; et par la suite elle l'appelait toujours " Je m'appelle Dalloway ! " »
Ce passage ne peut que faire grandement penser à Orgueil Et Préjugés, où les personnages de Wickham et de Darcy seraient ici respectivement Dalloway et Walsh, mais, contrairement à l'héroïne de Jane Austen, Clarissa choisira " Wickham ", celui qui présente bien...
Je reviens d'un voyage extraordinaire. Un voyage en Virginia. Il y a eu un avant Mrs Dalloway. Il y aura un après mais tout ce que je lirai désormais viendra se heurter à cet amour-là. Oui, à cet amour-là, car c 'est bien d'amour dont il s'agit et peut-on dire pourquoi l'on aime?
Ne cherchez pas d'histoire dans Mrs Dalloway car d'histoire il n'y en a pas! Je l'ai cherchée pourtant et le roman a bien failli me tomber des mains vers la page 50 tant j'étais déroutée qu'il ne s'y passe rien. Et puis, soudain, comme dans ces images qu'il faut fixer longtemps pour que nous apparaisse un monde en 3 D, j'ai plongé dans cet univers foisonnant et fascinant: le monde de Virginia! L'écriture est magnifique, d'une sensibilité et d'une poésie que je n'avais jamais rencontré jusque-là. Elle y décrit le souffle du vent dans les arbres et je sentais ce vent sur ma joue, je sentais les parfums de l'écorce. Mrs Dalloway fut pour moi avant tout un voyage sensoriel, je l'ai lu comme on rêve, l'esprit ouvert à toutes les sensations.
Mais plus encore ce livre est un merveilleux hymne à la féminité. Mrs Dalloway, c'est Virginia, c'est moi, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est toutes les femmes à la fois, c'est leur douleur et leur espoir qui est raconté là.
Je me souvenais de l'avoir lu pendant mes études. Il m'avait ennuyée et à présent je comprends pourquoi. Il y a un temps pour lire Mrs Dalloway. Il faut avoir senti la colère et le désir de vie gronder en soi. Et puis plus tard avoir senti, sur ses épaules, tout le poids des regrets. Il faut avoir aimé, il faut avoir pleuré, et trouvé enfin l'apaisement.
Ce livre, j'aurais aimé ne jamais le finir, et j'ai tout fait pour en prolonger la lecture, relisant plusieurs fois les mêmes passages et revenant sans cesse en arrière...
"Malgré tout, qu'à un jour succède un autre jour; mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qu'on se réveille le matin; qu'on voie le ciel; qu'on se promène dans le parc; qu'on rencontre Hugh Whitbread; puis que soudain débarque Peter; puis ces roses; cela suffisait. Après cela, la mort était inconcevable...l'idée que cela doive finir; et personne au monde ne saurait comme elle avait aimé tout cela; comment, à chaque instant..."
Oui, peut-on toujours dire pourquoi l'on aime? J'ai aimé Mrs Dalloway pour sa beauté et pour la grâce.
Ne cherchez pas d'histoire dans Mrs Dalloway car d'histoire il n'y en a pas! Je l'ai cherchée pourtant et le roman a bien failli me tomber des mains vers la page 50 tant j'étais déroutée qu'il ne s'y passe rien. Et puis, soudain, comme dans ces images qu'il faut fixer longtemps pour que nous apparaisse un monde en 3 D, j'ai plongé dans cet univers foisonnant et fascinant: le monde de Virginia! L'écriture est magnifique, d'une sensibilité et d'une poésie que je n'avais jamais rencontré jusque-là. Elle y décrit le souffle du vent dans les arbres et je sentais ce vent sur ma joue, je sentais les parfums de l'écorce. Mrs Dalloway fut pour moi avant tout un voyage sensoriel, je l'ai lu comme on rêve, l'esprit ouvert à toutes les sensations.
Mais plus encore ce livre est un merveilleux hymne à la féminité. Mrs Dalloway, c'est Virginia, c'est moi, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est toutes les femmes à la fois, c'est leur douleur et leur espoir qui est raconté là.
Je me souvenais de l'avoir lu pendant mes études. Il m'avait ennuyée et à présent je comprends pourquoi. Il y a un temps pour lire Mrs Dalloway. Il faut avoir senti la colère et le désir de vie gronder en soi. Et puis plus tard avoir senti, sur ses épaules, tout le poids des regrets. Il faut avoir aimé, il faut avoir pleuré, et trouvé enfin l'apaisement.
Ce livre, j'aurais aimé ne jamais le finir, et j'ai tout fait pour en prolonger la lecture, relisant plusieurs fois les mêmes passages et revenant sans cesse en arrière...
"Malgré tout, qu'à un jour succède un autre jour; mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qu'on se réveille le matin; qu'on voie le ciel; qu'on se promène dans le parc; qu'on rencontre Hugh Whitbread; puis que soudain débarque Peter; puis ces roses; cela suffisait. Après cela, la mort était inconcevable...l'idée que cela doive finir; et personne au monde ne saurait comme elle avait aimé tout cela; comment, à chaque instant..."
Oui, peut-on toujours dire pourquoi l'on aime? J'ai aimé Mrs Dalloway pour sa beauté et pour la grâce.
On a beaucoup parlé, beaucoup dit ou médit des qualités ou des défauts respectifs de tel ou tel exercice de traduction. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on ne jure plus que par la VO. « Oh ! ma pauvre, tu le lis en français, ce livre ?! Malheureuse, IL FAUT le lire en anglais, sans quoi tu perds tout ! » J'imagine qu'effectivement, ça doit être mieux — quand on maîtrise parfaitement la langue — de lire Tolstoï en russe, Pessoa en portugais, Pamuk en turc, Murakami en japonais, etc., etc. Mais, voilà, mes pauvres amis, mes capacités linguistiques étant ce qu'elles sont et me sentant déjà incapable de lire la Chanson de Roland en ancien français, ce qui est censé être ma propre langue dans sa version 1.0, qu'en sera-t-il du reste ?
C'est l'air du temps, il faut croire, l'ère du mondialisme à tout prix. On oublie, ou l'on feint d'oublier, que beaucoup d'oeuvres exceptionnelles de notre patrimoine littéraire francophone sont en réalité des traductions ou, plus exactement, des transcriptions ; c'est-à-dire que l'on se détache de la rigueur de la lettre pour en mieux conserver l'esprit, pour en révéler toute la force, pour magnifier toute la teneur du texte dans notre propre langue, ce qui est définitivement impossible si l'on colle de trop près à la lettre (ou si l'on est un locuteur somme toute moyen de la langue en question comme le sont bon nombre de ceux qui m'enjoignent de lire en VO).
Je cite, par exemple, le Cid de Corneille, transcription géniale de Guillén de Castro ; Dom Juan de Molière, transcrit de Tirso de Molina ; les Fables de la Fontaine, transcrites d'une brochette d'auteurs antiques. Plus proche de nous, on pourrait encore citer le Moine d'Antonin Artaud, transcrit de Lewis. Bref, chaque fois que d'authentiques auteurs se donnent la peine de transcrire un autre auteur dans leur langue, le résultat a des chances d'être à la hauteur des espérances, même si la lettre est outragée (cf la traduction de Poe par Baudelaire).
Mais les auteurs ne se donnent plus guère cette peine, on laisse la tâche aux traducteurs, qui, dans leur immense majorité sont des champions de la lettre mais pas forcément de l'esprit des oeuvres qu'ils traduisent. Les plus récents exemples d'oeuvres réellement transcrites en français et non pas simplement traduites sont peut-être celui de Finnegans Wake (car sa traduction simple était réputée infaisable) ou celui de Vie et Opinions de Tristram Shandy par Guy Jouvet, qui s'éloigne ainsi de l'ancienne traduction de Charles Mauron.
Alors si je m'éloigne — moi aussi ! — autant de l'oeuvre qui nous occupe aujourd'hui, c'est pour vous signaler un exercice de traduction — de traduction certes — mais quelle traduction, quelle somptueuse traduction ! le traducteur de Flush : une biographie, et qui n'est autre que le Charles Mauron précédemment cité mais qui, cette fois, pour Virginia Woolf, a réalisé un petit trésor d'orfèvrerie de la traduction.
Son texte coule, glisse, avance, pétille, frétille, fourmille, scintille à nos pupilles, émoustille nos papilles et tout ce que vous voudrez encore de rimes en « ille ». Il a su conserver, restituer, révéler l'esprit de son auteure, par delà la lettre et c'est un vrai bonheur à lire. Chapeau, donc, Monsieur Mauron, pour cette fidèle non traduction — sans oxymoron, cela va sans dire.
Qu'en est-il de l'oeuvre elle-même ? En 1932, c'est une Virginia Woolf qui possède déjà une grande expérience en matière d'écriture — certains diront « des heures de vol au compteur », ce dont je me garderai bien car j'approche dangereusement, et chaque jour davantage, de ce même âge fatidique. C'est une auteure, donc, qui a déjà trouvé son identité littéraire : le courant de conscience.
Immerger le lecteur dans la subjectivité (dans la tête) du personnage. Telle pourrait être, très succinctement, la définition du courant de conscience. Et c'est ici que se révèle la grande originalité (pour l'époque) de Virginia Woolf, en ce sens qu'elle prend le parti de nous faire pénétrer dans la tête d'un chien. Mais pas n'importe quel chien, un chien ayant réellement existé et pour lequel des éléments biographiques existent concrètement, puisqu'il s'agit du chien du couple Browning, l'un et l'autre poètes réputés de l'époque victorienne, ayant entretenu une épaisse correspondance au cours de leur vie. le chien, Flush, un cocker spaniel, appartenait, plus précisément à l'épouse, Elizabeth, née Barrett, avant même son mariage avec Robert Browning.
Virginia Woolf se livre à un exercice délicat, car largement hypothétique et lacunaire, mais pourtant balisé de nombreuses références authentiques. D'après moi, elle y excelle quoique… Quoique non, finalement, car, certes, elle a su trouver un ton fantastique, la dose exacte d'humour et de désinvolture qui convenait dans les trois premiers chapitres et le final, le tout allié à une grande pertinence avec son projet littéraire global du courant de conscience. Mais, oui, il y a un mais — et je rejoins totalement en cela le lecteur ileana dans sa critique : il y a ce qu'il appelle « une baisse de régime au milieu du récit » et que moi j'appellerais plutôt un changement de ton.
Virginia Woolf, dans les deux gros chapitres centraux et qui constituent à peu près la moitié de l'ouvrage, devient plus sérieuse, plus factuelle, moins distanciée. Ce n'est pas désagréable à lire, loin s'en faut, mais ce n'est plus du tout le même plaisir à la lecture, la même légèreté jouissive des premiers chapitres. Et donc, malgré sa grande expérience du roman, j'aurais tendance à lui adresser ce tout petit reproche : exercice réussi et maîtrisé dans l'ensemble, à l'exception de ce changement de ton non expliqué et apparemment non justifié au milieu, qui perturbe un peu la lecture et, en ce qui me concerne, m'a fait prendre beaucoup moins de plaisir que le début ou la toute fin du roman.
Vous êtes donc transportés, dans l'essentiel de l'oeuvre, à la place du chien. Vous percevez et interprétez les événements à la façon d'un chien du XIXème siècle, sans toutefois perdre votre double lecture d'humain spectateur du XXIème. On y lit également certains partis pris propres à Virginia Woolf, en sa qualité de femme écrivaine, appartenant à un milieu proche de celui auquel appartenait Elizabeth Barrett-Browning.
Très intéressant, donc, de mon point de vue, avec la petite limitation sus-mentionnée. Mais qui suis-je pour faire des remarques d'ordre stylistique à Virginia Woolf ? Je suis bien d'accord avec vous et par conséquent, gardez toujours à l'esprit que ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
C'est l'air du temps, il faut croire, l'ère du mondialisme à tout prix. On oublie, ou l'on feint d'oublier, que beaucoup d'oeuvres exceptionnelles de notre patrimoine littéraire francophone sont en réalité des traductions ou, plus exactement, des transcriptions ; c'est-à-dire que l'on se détache de la rigueur de la lettre pour en mieux conserver l'esprit, pour en révéler toute la force, pour magnifier toute la teneur du texte dans notre propre langue, ce qui est définitivement impossible si l'on colle de trop près à la lettre (ou si l'on est un locuteur somme toute moyen de la langue en question comme le sont bon nombre de ceux qui m'enjoignent de lire en VO).
Je cite, par exemple, le Cid de Corneille, transcription géniale de Guillén de Castro ; Dom Juan de Molière, transcrit de Tirso de Molina ; les Fables de la Fontaine, transcrites d'une brochette d'auteurs antiques. Plus proche de nous, on pourrait encore citer le Moine d'Antonin Artaud, transcrit de Lewis. Bref, chaque fois que d'authentiques auteurs se donnent la peine de transcrire un autre auteur dans leur langue, le résultat a des chances d'être à la hauteur des espérances, même si la lettre est outragée (cf la traduction de Poe par Baudelaire).
Mais les auteurs ne se donnent plus guère cette peine, on laisse la tâche aux traducteurs, qui, dans leur immense majorité sont des champions de la lettre mais pas forcément de l'esprit des oeuvres qu'ils traduisent. Les plus récents exemples d'oeuvres réellement transcrites en français et non pas simplement traduites sont peut-être celui de Finnegans Wake (car sa traduction simple était réputée infaisable) ou celui de Vie et Opinions de Tristram Shandy par Guy Jouvet, qui s'éloigne ainsi de l'ancienne traduction de Charles Mauron.
Alors si je m'éloigne — moi aussi ! — autant de l'oeuvre qui nous occupe aujourd'hui, c'est pour vous signaler un exercice de traduction — de traduction certes — mais quelle traduction, quelle somptueuse traduction ! le traducteur de Flush : une biographie, et qui n'est autre que le Charles Mauron précédemment cité mais qui, cette fois, pour Virginia Woolf, a réalisé un petit trésor d'orfèvrerie de la traduction.
Son texte coule, glisse, avance, pétille, frétille, fourmille, scintille à nos pupilles, émoustille nos papilles et tout ce que vous voudrez encore de rimes en « ille ». Il a su conserver, restituer, révéler l'esprit de son auteure, par delà la lettre et c'est un vrai bonheur à lire. Chapeau, donc, Monsieur Mauron, pour cette fidèle non traduction — sans oxymoron, cela va sans dire.
Qu'en est-il de l'oeuvre elle-même ? En 1932, c'est une Virginia Woolf qui possède déjà une grande expérience en matière d'écriture — certains diront « des heures de vol au compteur », ce dont je me garderai bien car j'approche dangereusement, et chaque jour davantage, de ce même âge fatidique. C'est une auteure, donc, qui a déjà trouvé son identité littéraire : le courant de conscience.
Immerger le lecteur dans la subjectivité (dans la tête) du personnage. Telle pourrait être, très succinctement, la définition du courant de conscience. Et c'est ici que se révèle la grande originalité (pour l'époque) de Virginia Woolf, en ce sens qu'elle prend le parti de nous faire pénétrer dans la tête d'un chien. Mais pas n'importe quel chien, un chien ayant réellement existé et pour lequel des éléments biographiques existent concrètement, puisqu'il s'agit du chien du couple Browning, l'un et l'autre poètes réputés de l'époque victorienne, ayant entretenu une épaisse correspondance au cours de leur vie. le chien, Flush, un cocker spaniel, appartenait, plus précisément à l'épouse, Elizabeth, née Barrett, avant même son mariage avec Robert Browning.
Virginia Woolf se livre à un exercice délicat, car largement hypothétique et lacunaire, mais pourtant balisé de nombreuses références authentiques. D'après moi, elle y excelle quoique… Quoique non, finalement, car, certes, elle a su trouver un ton fantastique, la dose exacte d'humour et de désinvolture qui convenait dans les trois premiers chapitres et le final, le tout allié à une grande pertinence avec son projet littéraire global du courant de conscience. Mais, oui, il y a un mais — et je rejoins totalement en cela le lecteur ileana dans sa critique : il y a ce qu'il appelle « une baisse de régime au milieu du récit » et que moi j'appellerais plutôt un changement de ton.
Virginia Woolf, dans les deux gros chapitres centraux et qui constituent à peu près la moitié de l'ouvrage, devient plus sérieuse, plus factuelle, moins distanciée. Ce n'est pas désagréable à lire, loin s'en faut, mais ce n'est plus du tout le même plaisir à la lecture, la même légèreté jouissive des premiers chapitres. Et donc, malgré sa grande expérience du roman, j'aurais tendance à lui adresser ce tout petit reproche : exercice réussi et maîtrisé dans l'ensemble, à l'exception de ce changement de ton non expliqué et apparemment non justifié au milieu, qui perturbe un peu la lecture et, en ce qui me concerne, m'a fait prendre beaucoup moins de plaisir que le début ou la toute fin du roman.
Vous êtes donc transportés, dans l'essentiel de l'oeuvre, à la place du chien. Vous percevez et interprétez les événements à la façon d'un chien du XIXème siècle, sans toutefois perdre votre double lecture d'humain spectateur du XXIème. On y lit également certains partis pris propres à Virginia Woolf, en sa qualité de femme écrivaine, appartenant à un milieu proche de celui auquel appartenait Elizabeth Barrett-Browning.
Très intéressant, donc, de mon point de vue, avec la petite limitation sus-mentionnée. Mais qui suis-je pour faire des remarques d'ordre stylistique à Virginia Woolf ? Je suis bien d'accord avec vous et par conséquent, gardez toujours à l'esprit que ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Virginia Woolf analyse avec ironie les causes du silence littéraire des femmes pendant de nombreuses décennies. Pour elle si les hommes jugent les femmes inférieures et les cantonnent dans des tâches subalternes c'est pour éviter de mettre en danger leur confiance en eux. Et comme les femmes qui n'ont pas accès aux études et ne sont pas autorisées à travailler sont dépendantes financièrement et intellectuellement, elles sont dans l'impossibilité de penser aux choses en elles-mêmes, donc d'écrire.
Heureusement au XIXe siècle des femmes ont bravé les interdits. Emily et Charlotte Brontë, George Eliot et surtout Jane Austen ont écrit, même si elles l'ont fait en cachette, sans chambre à elles pour s'isoler. Elles sont celles qui ont permis aux femmes d'accéder à la création littéraire. Des femmes qui par la suite ont acquis pour la plupart une indépendance financière grâce à leurs écrits.
Avec ce discours féministe Virginia Woolf montre les contraintes au développement de la littérature féminine dans une société patriarcale, mais aussi que " la littérature élisabéthaine aurait été très différente de ce qu'elle est si le féminisme avait pris naissance au XVIe siècle et non au XIXe."
Heureusement au XIXe siècle des femmes ont bravé les interdits. Emily et Charlotte Brontë, George Eliot et surtout Jane Austen ont écrit, même si elles l'ont fait en cachette, sans chambre à elles pour s'isoler. Elles sont celles qui ont permis aux femmes d'accéder à la création littéraire. Des femmes qui par la suite ont acquis pour la plupart une indépendance financière grâce à leurs écrits.
Avec ce discours féministe Virginia Woolf montre les contraintes au développement de la littérature féminine dans une société patriarcale, mais aussi que " la littérature élisabéthaine aurait été très différente de ce qu'elle est si le féminisme avait pris naissance au XVIe siècle et non au XIXe."
J'ai enfin découvert l'oeuvre de Virginia Woolf, avec son roman le plus connu, Mrs. Dalloway !
Ce roman nous plonge, le temps d'une journée, dans la vie du personnage éponyme, Clarissa. Alors qu'elle prépare une réception pour le soir même, elle fait le point sur sa vie lorsque son ancien soupirant -et ami- Peter Walsh, revenu récemment des Indes, lui rend visite. Mrs. Dalloway est une héroïne commune, humaine, ce qui sans doute fait d'elle un personnage profondément attachant. Le lecteur partage ses souvenirs, notamment le choix de se marier avec le député Richard Dalloway, mais aussi ses espérances pour sa soirée, et aussi pour son avenir...Bien évidemment, à travers Clarissa, nous devinons Virginia Woolf, elle-même, qui décrit avec une telle élégance les pensées de cette femme.
Parallèlement à la journée de Clarissa, le récit nous permet de rencontrer divers personnages qui évoluent dans la très grande ville de Londres, et parmi eux, Septimus Warren Smith, un jeune homme traumatisé par la guerre, qui sombre petit à petit dans la folie, malgré l'amour que lui porte sa femme, Lucrezia.
J'ai été extrêmement touchée par ces petits portraits d'hommes et de femmes, si différents, mais finalement liés par une même destinée, la mort.
Une très belle réflexion sur la condition humaine.
A lire !!
Ce roman nous plonge, le temps d'une journée, dans la vie du personnage éponyme, Clarissa. Alors qu'elle prépare une réception pour le soir même, elle fait le point sur sa vie lorsque son ancien soupirant -et ami- Peter Walsh, revenu récemment des Indes, lui rend visite. Mrs. Dalloway est une héroïne commune, humaine, ce qui sans doute fait d'elle un personnage profondément attachant. Le lecteur partage ses souvenirs, notamment le choix de se marier avec le député Richard Dalloway, mais aussi ses espérances pour sa soirée, et aussi pour son avenir...Bien évidemment, à travers Clarissa, nous devinons Virginia Woolf, elle-même, qui décrit avec une telle élégance les pensées de cette femme.
Parallèlement à la journée de Clarissa, le récit nous permet de rencontrer divers personnages qui évoluent dans la très grande ville de Londres, et parmi eux, Septimus Warren Smith, un jeune homme traumatisé par la guerre, qui sombre petit à petit dans la folie, malgré l'amour que lui porte sa femme, Lucrezia.
J'ai été extrêmement touchée par ces petits portraits d'hommes et de femmes, si différents, mais finalement liés par une même destinée, la mort.
Une très belle réflexion sur la condition humaine.
A lire !!
Eh bien, quelle étrange, et pourtant jolie, découverte que ce Mrs Dalloway, et je dois avouer qu'il y en a à dire sur lui.
Du point de vue de l’intrigue, il ne faut pas se mentir ni se voiler la face, alors non ! il ne se passe rien, ou quasiment rien ; certains passages semblent d’ailleurs bien longs et inutiles, mais en y regardant de plus près, c’est peut être eux qui donnent cette intensité, cette lumière, cette couleur si délicieuse et presque trop belle au reste du livre. Et puis, en dépit de cette évidente absence d’action, il faut avouer qu’émotionnellement parlant, Mrs Dalloway est un ouragan, un ouragan dévastateur et terriblement bouleversant.
On ne peut ressortir de cette lecture sans trouble ! Et on comprend qu’à travers cette Clarissa Dalloway, il y a surtout Virginia Woolf – il y a d’ailleurs beaucoup de similitudes entre la vie de ces deux héroïnes -, et puis à travers l’imperfection et la fragilité de cette femme, il y a toutes les femmes de l’époque mais aussi celles d’aujourd’hui, et inévitablement, elle nous renvoie à notre propre condition, notre propre personne, et l’on se voit nous et nos faiblesses. En tout cas, j’aime le pouvoir de la lutte féministe en littérature (peut être la seule qui me touche vraiment, et celle qui a le plus de sens à mes yeux), et à travers Mrs Dalloway (et c’était d’ailleurs pareil dans Une Chambre à Soi) les femmes sont vraiment remarquablement et subtilement mises à l’honneur, de quoi être vraiment fière d’être la paire de Virginia Woolf et de ses héroïnes.
Mais ce qui est fascinant avant tout, c’est la mise en scène de la folie (dont on lui attribuera les symptômes) et surtout son obsession pour l’eau qui est un élément très présent tout au long du récit (ce qui est assez troublant quand on sait qu’elle se suicidera - comme l’un des personnages qu’elle met en scène d’ailleurs, bien que différemment - en se laissant couler dans un fleuve…)
Un roman écrit avec grâce et à lire de toute son âme (mais pas l'aventurière, donc) et de tout son cœur.
A voir aussi, le film The Hours (qui aurait pu être le titre de Mrs Dalloway ! Virginia Woolf a longtemps hésité entre les deux), servi par les trois magnifiques actrices que sont Julianne Moore, Meryl Streep et Nicole Kidman (cette dernière jouant le rôle de l’auteure et ayant reçu l’oscar pour cette performance vraiment admirable). L’ayant vu avant de lire le livre, et ayant ressenti le même malaise lors de l’arrivée du générique de fin, je dois dire qu’il est vraiment réussi et fidèle à l’essence même du livre.
Du point de vue de l’intrigue, il ne faut pas se mentir ni se voiler la face, alors non ! il ne se passe rien, ou quasiment rien ; certains passages semblent d’ailleurs bien longs et inutiles, mais en y regardant de plus près, c’est peut être eux qui donnent cette intensité, cette lumière, cette couleur si délicieuse et presque trop belle au reste du livre. Et puis, en dépit de cette évidente absence d’action, il faut avouer qu’émotionnellement parlant, Mrs Dalloway est un ouragan, un ouragan dévastateur et terriblement bouleversant.
On ne peut ressortir de cette lecture sans trouble ! Et on comprend qu’à travers cette Clarissa Dalloway, il y a surtout Virginia Woolf – il y a d’ailleurs beaucoup de similitudes entre la vie de ces deux héroïnes -, et puis à travers l’imperfection et la fragilité de cette femme, il y a toutes les femmes de l’époque mais aussi celles d’aujourd’hui, et inévitablement, elle nous renvoie à notre propre condition, notre propre personne, et l’on se voit nous et nos faiblesses. En tout cas, j’aime le pouvoir de la lutte féministe en littérature (peut être la seule qui me touche vraiment, et celle qui a le plus de sens à mes yeux), et à travers Mrs Dalloway (et c’était d’ailleurs pareil dans Une Chambre à Soi) les femmes sont vraiment remarquablement et subtilement mises à l’honneur, de quoi être vraiment fière d’être la paire de Virginia Woolf et de ses héroïnes.
Mais ce qui est fascinant avant tout, c’est la mise en scène de la folie (dont on lui attribuera les symptômes) et surtout son obsession pour l’eau qui est un élément très présent tout au long du récit (ce qui est assez troublant quand on sait qu’elle se suicidera - comme l’un des personnages qu’elle met en scène d’ailleurs, bien que différemment - en se laissant couler dans un fleuve…)
Un roman écrit avec grâce et à lire de toute son âme (mais pas l'aventurière, donc) et de tout son cœur.
A voir aussi, le film The Hours (qui aurait pu être le titre de Mrs Dalloway ! Virginia Woolf a longtemps hésité entre les deux), servi par les trois magnifiques actrices que sont Julianne Moore, Meryl Streep et Nicole Kidman (cette dernière jouant le rôle de l’auteure et ayant reçu l’oscar pour cette performance vraiment admirable). L’ayant vu avant de lire le livre, et ayant ressenti le même malaise lors de l’arrivée du générique de fin, je dois dire qu’il est vraiment réussi et fidèle à l’essence même du livre.
N'avez-vous jamais regardé votre conjoint(e), au milieu d'un diner entre amis, et à sa façon de vous demander le sel, ne vous êtes-vous jamais dit, l'espace d'une seconde, « qu'ai-je jamais pu lui trouver finalement, comment ai-je pu ressentir quelque émotion ou sentiment ? » et la seconde d'après (à ce rictus que vous reconnaissez, que vous seul(e) comprenez) vous l'aimez à nouveau ? Et n'avez-vous jamais, (il (elle) attend toujours que vous lui passiez le sel) ressenti cette impression de découvrir un mot familier pour la première fois, « le sel » ? Comme ce mot est étrange soudainement. Vous êtes au pays du sel, submergé par une vague blanche et iodée. Et puis ça passe, il faut que ça passe, vous avez, du plus loin que votre mémoire s'en souvienne, toujours connu le « sel » …
Petula Clark chantait « Don't Sleep in the Subway » et bien moi je conseille « Don't Read in the Subway » ! Indeed, mieux vaut avoir « un lieu à soi » pour se laisser envelopper par « les vagues » d'émotions qui nous mènent « vers le phare ». Voilà, voilà…
« To the Lighthouse » est un roman de l'écrivaine et journaliste Virginia Woolf, paru en 1927. le livre suit la parution du succès Mrs. Dalloway, l'autrice anglaise est déjà une figure littéraire reconnue de son temps.
Le titre, « Promenade au phare » n'est pas une traduction exacte, il ne s'agit pas d'une balade mais d'un but, une tension ; on va vers le phare.
Ayant lu le livre en anglais, je ne sais pas si le titre est le fait de Marguerite Yourcenar, première à avoir traduit l'ouvrage de Woolf (qu'elle a même rencontré pour les besoins de la transcription). Les deux femmes ont beaucoup en commun, elles ont connu succès et gloire de leur vivant et elles ont assumé leur homosexualité. Ce qui est intéressant c'est de voir le souvenir nettement différent qu'elles ont de leur rencontre, Yourcenar, jeune écrivain, est impressionnée par Woolf et peut-être veut avoir une conversation d'écrivain à écrivain, tandis que Woolf n'accorde que quelques lignes de son journal à cette rencontre et retient surtout que sa traductrice se posait des questions d'ordre techniques passablement ennuyeuses…
Yourcenar est trop imposante, trop écrivaine pour s'effacer complètement derrière la traduction, je la soupçonne - peut-être gratuitement – d'avoir fait quelques petites contributions. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça pourrait même être un bel exercice de littérature comparée (si certains ont lu la version de Yourcenar ?).
L'ambiance est pesante et légère à la fois. Quelques traits d'ironie ponctuent le récit, les scènes dépeignant les relations entre hommes et femmes, prêtent à sourire.
Le livre à mon sens, traite de la communication, ce mot un peu vulgaire aujourd'hui, un peu tricheur, un peu menteur, un peu vendeur… En tout cas de la difficulté à communiquer, de l'envie de communiquer, de la différence entre l'intention de l'envoyeur du message (verbal, physique) et la façon dont peut l'interpréter le receveur.
C'est un roman qui fait la part belle à la gêne, dont Roland Barthes donne une définition parfaite : « Je sais que tu sais que je sais : telle est la formule générale de la gêne. » Seulement avec Woolf on sait mais sans vraiment toujours savoir ce qu'on sait, jusqu'à la certitude qui s'éclaire, comme un ciel dégagé après la brume maritime.
Le roman se découpe en trois parties et débute sur une île, quelque part en Ecosse, une famille de huit enfants et leurs parents Mr & Mrs Ramsay reçoivent des amis : écrivain, scientifique, artiste peintre pour passer des vacances. le petit James veut aller au phare, sa mère aimerait l'y emmener mais son père ne pense pas que la promenade soit possible…
“She often felt she was nothing but a sponge sopped full of human emotions.” le choix de Woolf : concentrer le récit sur une période très courte, explorer l'écosystème émotionnel si riche de détails qui se nourrit des interactions multiples et souvent silencieuses des personnages au cours d'une seule journée.
Il est frappant de constater à quel point l'environnement extérieur n'intéresse pas Woolf, les descriptions sont assez sommaires, mais plus que la nature (souvent utilisée -notamment les vagues- comme métaphore des pensées), les rapports sociaux, la critique sociale (pourtant présente dans son oeuvre journalistique et ses essais) ne sont pas non plus présents dans son ouvrage, contrairement aux considérations fleuves de D.H Lawrence par exemple sur la société de son temps.
Est-ce à dire que Virginia est une écrivaine « d'intérieur » (une écrivaine du « confinement » dirait-t-on en 2020) ? Disons plutôt qu'elle explore un paysage parallèle au monde extérieur, celui du fleuve des émotions, des perceptions, de l'interprétation des faits et gestes, qui abreuve la littérature classique depuis plusieurs siècles. Chaque auteur ayant sa propre embarcation de fortune pour remonter le cours des émotions.
Il n'est pas aisé d'entrer dans l'oeuvre de Woolf, outre l'absence d'action (qui n'est pas propre à son oeuvre), il y a une façon d'écrire qui demande au lecteur un véritable effort. On ne peut pas lire quelques pages à la dérobée ou couper la lecture à n'importe quel endroit, la métrique de Virginia Woolf s'accommode mal des césures que les obligations de la vie quotidienne imposent au lecteur.
On voudrait lire le livre d'une traite car chaque fois qu'on se replonge dans la lecture, l'effort est renouvelé et se poursuit parfois sur quelques pages. La façon qu'a Woolf de passer insensiblement d'un personnage à l'autre, d'un monologue l'autre, sans en avertir le lecteur, supposé (re)connaître chaque état d'âme, est déroutante. de même que son usage de la parenthèse, souvent pour décrire magistralement comme la vie matérielle continue de façon dérisoire et impérative, au milieu du flot des pensées, et même parfois entre en résonnance souterraine avec ces pensées.
On a l'impression que ce n'est pas la vie qui écrase le monologue intérieur, mais l'inverse, peut-être signe des fragilités et acuités mentales de Woolf, la vie est secondaire, presque facultative, ce sont les pensées, la vie intérieure, la vie des émotions, la « vraie vie ».
Mais l'effort est aussi un ressort de complicité entre le lecteur et les personnages. En suivant la pensée du personnage nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il s'est réellement passé et de ce qui relève de la mémoire qui s'embrouille, qui fantasme, « oh no that she had invented » se dit à elle-même Mrs. Ramsey, se créant un souvenir de toute pièce, ce que confirme le lecteur, ou encore le jeu d'imagination auquel se prête Lily Briscoe pour les besoins du tableau.
“Why should they grow up and lose all that? (…) And then she said to herself, brandishing her sword at life, Nonsense.” La vie de l'écrivaine anglaise transpire dans ce roman, la relation particulièrement lucide au mariage qu'ont les personnages féminins, dans une société patriarcale, trahit le mariage troublée de l'autrice avec Leonard Woolf, l'effervescence culturelle qui n'est pas sans rappeler la colocation de Bloomsbury où Virginia et sa soeur, artiste peintre, vécurent une vie de bohème aux côtés notamment de l'économiste Keynes, enfin, l'île écossaise, la maison de villégiature près de la mer et le couple Ramsay sont inspirés du paradis perdu de la petite Virginia dans sa maison des Cornouailles de cette « happiness » (le mot bonheur, être heureux, un leitmotiv chez Woolf, jusqu'à son ultime lettre d'adieu), avec sa mère, disparue trop tôt, et son père avec lequel elle entretint une relation conflictuelle.
Si le livre prête une attention aux détails, minute par minute, il est aussi un roman du temps qui passe et de ceux qui restent.
Le rapport à la finitude, à la mort est très délicat, il y a une politesse de la pudeur, une résilience digne et fragile qui me rappelle cette réponse d'Euripide à une lamentation « Hélas ! Pourquoi Hélas ? C'est le lot des mortels. »
Qu'en pensez-vous ?
Petula Clark chantait « Don't Sleep in the Subway » et bien moi je conseille « Don't Read in the Subway » ! Indeed, mieux vaut avoir « un lieu à soi » pour se laisser envelopper par « les vagues » d'émotions qui nous mènent « vers le phare ». Voilà, voilà…
« To the Lighthouse » est un roman de l'écrivaine et journaliste Virginia Woolf, paru en 1927. le livre suit la parution du succès Mrs. Dalloway, l'autrice anglaise est déjà une figure littéraire reconnue de son temps.
Le titre, « Promenade au phare » n'est pas une traduction exacte, il ne s'agit pas d'une balade mais d'un but, une tension ; on va vers le phare.
Ayant lu le livre en anglais, je ne sais pas si le titre est le fait de Marguerite Yourcenar, première à avoir traduit l'ouvrage de Woolf (qu'elle a même rencontré pour les besoins de la transcription). Les deux femmes ont beaucoup en commun, elles ont connu succès et gloire de leur vivant et elles ont assumé leur homosexualité. Ce qui est intéressant c'est de voir le souvenir nettement différent qu'elles ont de leur rencontre, Yourcenar, jeune écrivain, est impressionnée par Woolf et peut-être veut avoir une conversation d'écrivain à écrivain, tandis que Woolf n'accorde que quelques lignes de son journal à cette rencontre et retient surtout que sa traductrice se posait des questions d'ordre techniques passablement ennuyeuses…
Yourcenar est trop imposante, trop écrivaine pour s'effacer complètement derrière la traduction, je la soupçonne - peut-être gratuitement – d'avoir fait quelques petites contributions. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça pourrait même être un bel exercice de littérature comparée (si certains ont lu la version de Yourcenar ?).
L'ambiance est pesante et légère à la fois. Quelques traits d'ironie ponctuent le récit, les scènes dépeignant les relations entre hommes et femmes, prêtent à sourire.
Le livre à mon sens, traite de la communication, ce mot un peu vulgaire aujourd'hui, un peu tricheur, un peu menteur, un peu vendeur… En tout cas de la difficulté à communiquer, de l'envie de communiquer, de la différence entre l'intention de l'envoyeur du message (verbal, physique) et la façon dont peut l'interpréter le receveur.
C'est un roman qui fait la part belle à la gêne, dont Roland Barthes donne une définition parfaite : « Je sais que tu sais que je sais : telle est la formule générale de la gêne. » Seulement avec Woolf on sait mais sans vraiment toujours savoir ce qu'on sait, jusqu'à la certitude qui s'éclaire, comme un ciel dégagé après la brume maritime.
Le roman se découpe en trois parties et débute sur une île, quelque part en Ecosse, une famille de huit enfants et leurs parents Mr & Mrs Ramsay reçoivent des amis : écrivain, scientifique, artiste peintre pour passer des vacances. le petit James veut aller au phare, sa mère aimerait l'y emmener mais son père ne pense pas que la promenade soit possible…
“She often felt she was nothing but a sponge sopped full of human emotions.” le choix de Woolf : concentrer le récit sur une période très courte, explorer l'écosystème émotionnel si riche de détails qui se nourrit des interactions multiples et souvent silencieuses des personnages au cours d'une seule journée.
Il est frappant de constater à quel point l'environnement extérieur n'intéresse pas Woolf, les descriptions sont assez sommaires, mais plus que la nature (souvent utilisée -notamment les vagues- comme métaphore des pensées), les rapports sociaux, la critique sociale (pourtant présente dans son oeuvre journalistique et ses essais) ne sont pas non plus présents dans son ouvrage, contrairement aux considérations fleuves de D.H Lawrence par exemple sur la société de son temps.
Est-ce à dire que Virginia est une écrivaine « d'intérieur » (une écrivaine du « confinement » dirait-t-on en 2020) ? Disons plutôt qu'elle explore un paysage parallèle au monde extérieur, celui du fleuve des émotions, des perceptions, de l'interprétation des faits et gestes, qui abreuve la littérature classique depuis plusieurs siècles. Chaque auteur ayant sa propre embarcation de fortune pour remonter le cours des émotions.
Il n'est pas aisé d'entrer dans l'oeuvre de Woolf, outre l'absence d'action (qui n'est pas propre à son oeuvre), il y a une façon d'écrire qui demande au lecteur un véritable effort. On ne peut pas lire quelques pages à la dérobée ou couper la lecture à n'importe quel endroit, la métrique de Virginia Woolf s'accommode mal des césures que les obligations de la vie quotidienne imposent au lecteur.
On voudrait lire le livre d'une traite car chaque fois qu'on se replonge dans la lecture, l'effort est renouvelé et se poursuit parfois sur quelques pages. La façon qu'a Woolf de passer insensiblement d'un personnage à l'autre, d'un monologue l'autre, sans en avertir le lecteur, supposé (re)connaître chaque état d'âme, est déroutante. de même que son usage de la parenthèse, souvent pour décrire magistralement comme la vie matérielle continue de façon dérisoire et impérative, au milieu du flot des pensées, et même parfois entre en résonnance souterraine avec ces pensées.
On a l'impression que ce n'est pas la vie qui écrase le monologue intérieur, mais l'inverse, peut-être signe des fragilités et acuités mentales de Woolf, la vie est secondaire, presque facultative, ce sont les pensées, la vie intérieure, la vie des émotions, la « vraie vie ».
Mais l'effort est aussi un ressort de complicité entre le lecteur et les personnages. En suivant la pensée du personnage nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il s'est réellement passé et de ce qui relève de la mémoire qui s'embrouille, qui fantasme, « oh no that she had invented » se dit à elle-même Mrs. Ramsey, se créant un souvenir de toute pièce, ce que confirme le lecteur, ou encore le jeu d'imagination auquel se prête Lily Briscoe pour les besoins du tableau.
“Why should they grow up and lose all that? (…) And then she said to herself, brandishing her sword at life, Nonsense.” La vie de l'écrivaine anglaise transpire dans ce roman, la relation particulièrement lucide au mariage qu'ont les personnages féminins, dans une société patriarcale, trahit le mariage troublée de l'autrice avec Leonard Woolf, l'effervescence culturelle qui n'est pas sans rappeler la colocation de Bloomsbury où Virginia et sa soeur, artiste peintre, vécurent une vie de bohème aux côtés notamment de l'économiste Keynes, enfin, l'île écossaise, la maison de villégiature près de la mer et le couple Ramsay sont inspirés du paradis perdu de la petite Virginia dans sa maison des Cornouailles de cette « happiness » (le mot bonheur, être heureux, un leitmotiv chez Woolf, jusqu'à son ultime lettre d'adieu), avec sa mère, disparue trop tôt, et son père avec lequel elle entretint une relation conflictuelle.
Si le livre prête une attention aux détails, minute par minute, il est aussi un roman du temps qui passe et de ceux qui restent.
Le rapport à la finitude, à la mort est très délicat, il y a une politesse de la pudeur, une résilience digne et fragile qui me rappelle cette réponse d'Euripide à une lamentation « Hélas ! Pourquoi Hélas ? C'est le lot des mortels. »
Qu'en pensez-vous ?
Il ne se passe rien dans ce livre.
C’est-à-dire, pour être honnête, qu’il ne s’y passe presque rien. C’est qu’en effet, on y prépare et on y participe à une vague soirée mondaine. Ce qui n’est pas rien, peut-être, mais on admettra tout de même que ce n’est pas trop loin de l’être.
Et pourtant, on s’en fou complètement de la vacuité de la trame romanesque de ce chef-d’œuvre, car ce qui s’y passe de vraiment intéressant, c’est une véritable révolution littéraire!
C’est qu’il y a déjà eu un temps où les femmes n’avaient pas le droit d’écrire! Aussi fou que cela puisse paraître aujourd’hui, elles devaient alors se cacher pour leurs publications derrière le nom d’un homme quelconque ou prendre un pseudonyme. Et même lorsque l’inique interdiction disparût, l’écriture a continuée à être dominée par les tendances à la linéarité et à la logique propre au masculin.
Et voilà que soudainement, brusquement (du moins pour mon humble personne), on trouve ici l’écriture d’une femme qui se déploie telle qu’elle existe et pense réellement dans sa féminité. On tombe sur une pensée qui vous saute au visage, qui vous fait rêver, qui vous ennuie aussi parfois, mais toujours pour rebondir encore mieux et raviver d’avantage votre intérêt au passage suivant. Partout, les fils s’entrecroisent sans se perdre, ou enfin, peut-être qu’ils se perdent parfois, mais qui sait s’ils ne perdent rien pour attendre? Après tout, on ne suit Mrs Dalloway que quelques heures et on ne la suit que dans la mesure où on y parvient vraiment.
Le tout m’a complètement enchanté, amusé et séduit. Je me suis senti comme en conversation avec une jolie femme intelligente, piquante d’imagination, d’ironie et d’espièglerie qui ne me laisse pas le temps d’en placer une.
Oui! Je t’écoute ma chère! Oui! Je t’écoute!
Mes yeux, pétillants aux rythmes des charmants feux d’artifices de ton esprit ne te le prouvent-ils pas amplement?
C’est-à-dire, pour être honnête, qu’il ne s’y passe presque rien. C’est qu’en effet, on y prépare et on y participe à une vague soirée mondaine. Ce qui n’est pas rien, peut-être, mais on admettra tout de même que ce n’est pas trop loin de l’être.
Et pourtant, on s’en fou complètement de la vacuité de la trame romanesque de ce chef-d’œuvre, car ce qui s’y passe de vraiment intéressant, c’est une véritable révolution littéraire!
C’est qu’il y a déjà eu un temps où les femmes n’avaient pas le droit d’écrire! Aussi fou que cela puisse paraître aujourd’hui, elles devaient alors se cacher pour leurs publications derrière le nom d’un homme quelconque ou prendre un pseudonyme. Et même lorsque l’inique interdiction disparût, l’écriture a continuée à être dominée par les tendances à la linéarité et à la logique propre au masculin.
Et voilà que soudainement, brusquement (du moins pour mon humble personne), on trouve ici l’écriture d’une femme qui se déploie telle qu’elle existe et pense réellement dans sa féminité. On tombe sur une pensée qui vous saute au visage, qui vous fait rêver, qui vous ennuie aussi parfois, mais toujours pour rebondir encore mieux et raviver d’avantage votre intérêt au passage suivant. Partout, les fils s’entrecroisent sans se perdre, ou enfin, peut-être qu’ils se perdent parfois, mais qui sait s’ils ne perdent rien pour attendre? Après tout, on ne suit Mrs Dalloway que quelques heures et on ne la suit que dans la mesure où on y parvient vraiment.
Le tout m’a complètement enchanté, amusé et séduit. Je me suis senti comme en conversation avec une jolie femme intelligente, piquante d’imagination, d’ironie et d’espièglerie qui ne me laisse pas le temps d’en placer une.
Oui! Je t’écoute ma chère! Oui! Je t’écoute!
Mes yeux, pétillants aux rythmes des charmants feux d’artifices de ton esprit ne te le prouvent-ils pas amplement?
Virginia Woolf fait partie de mes auteurs fétiches et pourtant jamais encore je n'ai osé écrire le moindre avis sur une de ses oeuvres. Je souhaite remercier ici l'ami qui a exaucé un de mes voeux en m'offrant un exemplaire de la Chambre de Jacob dans l'édition à la couverture bleue de 1929.
L'écriture de Virginia Woolf me bouleverse, j'aime sa manière d'appréhender et de décrire le monde alors que je la qualifierais volontiers de cérébrale et ne comprends pas toujours où elle veut m'emmener. Cette oeuvre ressemble pour moi à un éloge funèbre. Jacob est décrit par différentes personnes de son entourage qui en montrent tour à tour une facette, un aspect, à un moment donné. Virginia Woolf nous propose un portrait éclaté et nous invite à recoller tous les morceaux à notre disposition pour avoir une idée approximative de qui il pouvait bien s'agir. Jacob est donc tout à la fois le grand absent et celui dont on parle sans cesse. Sa chambre, une pièce désormais inhabitée qui rassemble encore les objets qu'il a aimés, les livres sur une étagère, une paire de chaussures qui traînent. Cette lecture se présente pour moi comme une chasse aux indices. Rien n'est laissé au hasard, les collections, les livres cités, les dates, les pétales de coquelicot oubliés dans un ouvrage. Des petits cailloux blancs semés qui nous permettent de comprendre le dénouement sans que celui-ci soit explicite, le tout doublé de références autobiographiques de l'auteur.
L'écriture de Virginia Woolf me bouleverse, j'aime sa manière d'appréhender et de décrire le monde alors que je la qualifierais volontiers de cérébrale et ne comprends pas toujours où elle veut m'emmener. Cette oeuvre ressemble pour moi à un éloge funèbre. Jacob est décrit par différentes personnes de son entourage qui en montrent tour à tour une facette, un aspect, à un moment donné. Virginia Woolf nous propose un portrait éclaté et nous invite à recoller tous les morceaux à notre disposition pour avoir une idée approximative de qui il pouvait bien s'agir. Jacob est donc tout à la fois le grand absent et celui dont on parle sans cesse. Sa chambre, une pièce désormais inhabitée qui rassemble encore les objets qu'il a aimés, les livres sur une étagère, une paire de chaussures qui traînent. Cette lecture se présente pour moi comme une chasse aux indices. Rien n'est laissé au hasard, les collections, les livres cités, les dates, les pétales de coquelicot oubliés dans un ouvrage. Des petits cailloux blancs semés qui nous permettent de comprendre le dénouement sans que celui-ci soit explicite, le tout doublé de références autobiographiques de l'auteur.
Virginia Woolf excelle dans l'étude des caractères.
Ce recueil de nouvelles lui sert de terrain de jeu pour y mêler ses impressions, ses critiques et ses jugements souvent impertinents et d'ébaucher ainsi le personnage de Mrs Dalloway, qui sera par la suite l'un de ses romans les plus connus.
La finesse de l'écriture nous renvoie comme en un effet miroir nos propres visions, souvenirs, aspirations ou désespérances.
Sous l'apparence de la comédie c'est tout un portrait de la société londonienne de l'après la première guerre mondiale et de ses petits travers qui se jouent dans ce microscope grinçant et touchant.
Ce recueil de nouvelles lui sert de terrain de jeu pour y mêler ses impressions, ses critiques et ses jugements souvent impertinents et d'ébaucher ainsi le personnage de Mrs Dalloway, qui sera par la suite l'un de ses romans les plus connus.
La finesse de l'écriture nous renvoie comme en un effet miroir nos propres visions, souvenirs, aspirations ou désespérances.
Sous l'apparence de la comédie c'est tout un portrait de la société londonienne de l'après la première guerre mondiale et de ses petits travers qui se jouent dans ce microscope grinçant et touchant.
Virginia Woolf écrit à ses amis des lettres intimes, drôles, caustiques, affectueuses. Des amis, qui sont plus souvent des amies (seules les femmes stimulent mon imagination dit-elle), à qui elle parle, souvent avec autodérision, de la façon dont elle se juge, de ce qui la préoccupe. À qui elle se confie d'un ton étonnamment libre et audacieux sur sa fragilité, sur son idée du mariage et de la maternité — qu'elle juge encore plus destructrice et contraignante, de l'embarras de ses proches à lire ses livres pas toujours faciles. Mais surtout que ce soit à Nelly Cecil, à Katharine Arnold-Foster ou encore à sa bien-aimée Vita Sackville-West, à qui elle intime gentiment l'ordre d'écrire une oeuvre littéraire : « La littérature est, sans l'ombre d'un doute, l'unique profession intellectuelle et humaine qui vaille. Même la peinture tend à la pesanteur, et la musique rend les gens lascifs ; tandis que plus on écrit, meilleur on devient. » livre-t-elle à sa très chère Ka.
Des lettres parues dans cette formidable collection Les Plis qui offre une sélection de correspondances, souvent inédites en France, présentée dans une enveloppe en vue d'une expédition (ce que, bien entendu, je me garderai égoïstement de faire 😊).
Challenge MULTI-DEFIS 2023
Des lettres parues dans cette formidable collection Les Plis qui offre une sélection de correspondances, souvent inédites en France, présentée dans une enveloppe en vue d'une expédition (ce que, bien entendu, je me garderai égoïstement de faire 😊).
Challenge MULTI-DEFIS 2023
Ces voix qui s'entremêlent sans jamais se toucher, ces personnages qui n'en sont pas parce qu'ils ne sont que des paroles, cette quête désespérée d'une unité du moi, tantôt approchée, tantôt éloignée, ce mouvement de la vague, va-et-vient des personnages les uns vers les autres et vers eux-mêmes, ce rythme qui fait oublier qui parle parce que Bernard, Neville, Louis, Suzanne, Jinny et Rhoda sont une seule voix même s'il y a des restes de personnages, des situations particulières irréductiblement différentes, Bernard qui raconte des histoires, qui prend la parole au point de la monopoliser à la fin du roman, Bernard qui est une vague, tantôt trouvant le calme de la solitude, un rivage possible, puis retrouvant les détails de la vie ordinaire qui lui font raconter des histoires, se perdre, n'être plus que Bernard qui écrit des phrases dans un carnet, Neville qui aime, Suzanne qui s'enracine, devient un arbre, Louis qui efface son accent australien, Jinny qui n'est qu'un corps, Rhoda qui est un fantôme sans visage. Mais tous sont des fantômes sans visage.
Il y a au coeur de ce roman une absence, la mort de Perceval, dont on n'entend jamais la voix mais qui est au centre de tout. Quelque chose flotte. Les personnages s'estompent et font place aux paysages. Perceval est mort et n'a jamais existé. J'ai la bizarre impression de ne pouvoir parler de ce livre qu'en en prenant le style, cette constante analyse intérieure qui fait que quelque chose échappe toujours, et que quelque chose, c'est tout.
Il y a dans Les Vagues un condensé de l'expérience humaine moderne, cette avancée dans la vie où tout évolue sans vraiment changer, les souffrances et peut-être, mais ça semble moins sûr chez Virginia Woolf, les joies prenant juste plus de poids, mais les mardis succèdent aux lundis indéfiniment et les vagues ne cessent pas de se heurter contre le rivage. Il n'y a jamais de rupture dans ce texte, malgré ses six narrateurs que tout oppose et que tout réunit, ses descriptions de paysages qui viennent interrompre les monologues, les années qui passent de l'enfance à l'âge mûr. Même la mort de Perceval ne parvient pas à briser la monotonie du roman, parce que Perceval n'existait pas avant sa mort.
Nos vies, ma vie (comme les personnages de ce roman, j'oscille sans cesse entre mon identité personnelle et mon identité humaine) coulent sans que nous trouvions (sans que je trouve) qui nous sommes (qui je suis). Solitude à la fois irrémédiable et impossible, désirée et rejetée de toutes mes forces, comme l'appel de l'autre qui fait de moi à la fois un Neville disant à l'autre "viens plus près", et une Rhoda, que l'autre horrifie et qui se cache, se vampirise, et tout à coup, sans crier gare, se retrouve morte.
Il y a au coeur de ce roman une absence, la mort de Perceval, dont on n'entend jamais la voix mais qui est au centre de tout. Quelque chose flotte. Les personnages s'estompent et font place aux paysages. Perceval est mort et n'a jamais existé. J'ai la bizarre impression de ne pouvoir parler de ce livre qu'en en prenant le style, cette constante analyse intérieure qui fait que quelque chose échappe toujours, et que quelque chose, c'est tout.
Il y a dans Les Vagues un condensé de l'expérience humaine moderne, cette avancée dans la vie où tout évolue sans vraiment changer, les souffrances et peut-être, mais ça semble moins sûr chez Virginia Woolf, les joies prenant juste plus de poids, mais les mardis succèdent aux lundis indéfiniment et les vagues ne cessent pas de se heurter contre le rivage. Il n'y a jamais de rupture dans ce texte, malgré ses six narrateurs que tout oppose et que tout réunit, ses descriptions de paysages qui viennent interrompre les monologues, les années qui passent de l'enfance à l'âge mûr. Même la mort de Perceval ne parvient pas à briser la monotonie du roman, parce que Perceval n'existait pas avant sa mort.
Nos vies, ma vie (comme les personnages de ce roman, j'oscille sans cesse entre mon identité personnelle et mon identité humaine) coulent sans que nous trouvions (sans que je trouve) qui nous sommes (qui je suis). Solitude à la fois irrémédiable et impossible, désirée et rejetée de toutes mes forces, comme l'appel de l'autre qui fait de moi à la fois un Neville disant à l'autre "viens plus près", et une Rhoda, que l'autre horrifie et qui se cache, se vampirise, et tout à coup, sans crier gare, se retrouve morte.
Encore un texte magnifique, qui a l'inconvénient d'enterrer tous les autres...Après Virginia, ils semblent l'oeuvre de tâcherons poussifs...Enfin, ça va me passer...
En parler, c'est l'amoindrir. Lui chercher un sens et une symbolique, c'est le diminuer. Comme les Illuminations de Rimbaud, il faut juste le lire et laisser s'épanouir en soi les mille images et sentiments et sensations gigantesques ou infimes qui sont décrites. Tout se mêle et s'entremêle autour d'un fil ténu, un couple, une maison de vacances,une île d'Ecosse, la mer, un phare, un jardin, une fenêtre, des gens, des enfants, des paroles prononcées ou non, des pensées secrètes.
On peut quand même dire : une femme, Mrs Ramsay, est, se sent, est peut-être, le centre de gravité d'une famille de huit enfants, un mari, des amis en villégiature. Le benjamin, James, désire se rendre au phare en bateau. Sa mère lui dit qu'ils iront le lendemain, mais son père déclare qu'il fera mauvais, le vent souffle de l'ouest. La journée se passe et, comme dans Mrs Dalloway, elle condense l'essentiel des personnages. La narratrice, esprit fluide, passe d'une psyché à l'autre parmi les personnages, comme le flux et le reflux de la marée, et se laisse imprégner de tous leurs mouvements. Mrs Ramsay et son mari, qui la dévore -ou bien c'est l'inverse-, d'une beauté invraisemblable, fascinant la peintre Lily Briscoe, qui tente, du jardin, de la peindre, derrière sa fenêtre, mère à l'enfant avec son fils James, le jeune Charles Tansey, cherchant sa place, désagréable, fasciné lui aussi, William Bankes, l'ami de Ramsay, résistant au charme de Mrs Ramsay, Paul et Minta qu'elle veut marier, les enfants qui la vénèrent...Le dîner, le boeuf en daube, le coucher, fin de la journée, tempête. A la différence de Mrs Dalloway cependant, le récit repart, "le Temps passe" et "Le Phare" constituent une suite profondément triste et mélancolique à la magnifique journée d'été de la première partie.
Voilà, j'en ai trop dit. Il y a beaucoup plus que cela. C'est une illumination.
En parler, c'est l'amoindrir. Lui chercher un sens et une symbolique, c'est le diminuer. Comme les Illuminations de Rimbaud, il faut juste le lire et laisser s'épanouir en soi les mille images et sentiments et sensations gigantesques ou infimes qui sont décrites. Tout se mêle et s'entremêle autour d'un fil ténu, un couple, une maison de vacances,une île d'Ecosse, la mer, un phare, un jardin, une fenêtre, des gens, des enfants, des paroles prononcées ou non, des pensées secrètes.
On peut quand même dire : une femme, Mrs Ramsay, est, se sent, est peut-être, le centre de gravité d'une famille de huit enfants, un mari, des amis en villégiature. Le benjamin, James, désire se rendre au phare en bateau. Sa mère lui dit qu'ils iront le lendemain, mais son père déclare qu'il fera mauvais, le vent souffle de l'ouest. La journée se passe et, comme dans Mrs Dalloway, elle condense l'essentiel des personnages. La narratrice, esprit fluide, passe d'une psyché à l'autre parmi les personnages, comme le flux et le reflux de la marée, et se laisse imprégner de tous leurs mouvements. Mrs Ramsay et son mari, qui la dévore -ou bien c'est l'inverse-, d'une beauté invraisemblable, fascinant la peintre Lily Briscoe, qui tente, du jardin, de la peindre, derrière sa fenêtre, mère à l'enfant avec son fils James, le jeune Charles Tansey, cherchant sa place, désagréable, fasciné lui aussi, William Bankes, l'ami de Ramsay, résistant au charme de Mrs Ramsay, Paul et Minta qu'elle veut marier, les enfants qui la vénèrent...Le dîner, le boeuf en daube, le coucher, fin de la journée, tempête. A la différence de Mrs Dalloway cependant, le récit repart, "le Temps passe" et "Le Phare" constituent une suite profondément triste et mélancolique à la magnifique journée d'été de la première partie.
Voilà, j'en ai trop dit. Il y a beaucoup plus que cela. C'est une illumination.
"En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l'homme. En dedans, il fait trop noir pour y lire."
(Groucho Marx)
Quand j'ai appris que Virginia Woolf avait écrit un petit roman biographique sur Elizabeth Barrett-Browning, raconté du point de vue de son cocker, je l'ai tout de suite classé mentalement dans la catégorie "décidément à lire". Et je suis relativement déçue... quoique, oui, dans certains cas ce livre peut s'avérer idéal. J'ai d'abord planifié que la lecture de "Flush" me permettra de procrastiner pendant mes travaux de rénovation domestique... finalement ce fut le contraire, et par conséquent j'ai achevé toutes mes bricoles beaucoup plus vite que prévu.
On trottera au pas de l'épagneul Flush, qui, encore tout jeune chien, arrive dans la luxueuse maison de la célèbre poétesse. Un cadeau de la modeste famille des Milford à leur chère mademoiselle Barrett, dont l'esprit si merveilleusement vif reste emprisonné dans un corps si regrettablement inerte. La peur et la langueur du jeune chiot vont se transformer peu à peu en amour inconditionnel entre Flush et sa nouvelle maîtresse. Flush va renoncer à sa liberté, aux lapins et aux galipettes à l'air libre, et tout cela rien que pour elle. Les choses se compliqueront quelque peu, quand Miss Barrett tombera amoureuse de Mr Browning...
Mon plus grand problème avec le livre se trouve dans la conception du protagoniste principal, coincée quelque part à mi-chemin entre l'anthropomorphisation et le portrait fidèle d'un animal. Virginia Woolf ne propose décidément pas une image réaliste de la mentalité canine, comme le fait, disons, Eric Knight dans "Lassie" (par exemple, en observant les occupations de sa maîtresse, Flush souhaite savoir écrire comme elle). le monde à travers les yeux noisette de l'épagneul reste cependant très différent du nôtre, ce qui réduit l'angle de vue du narrateur lié au personnage de Flush. le résultat est une pelote emmêlée d'observations qui ne sont ni tout à fait humaines, ni tout à fait canines. C'est pourtant un des points intéressants du récit : l'absence de langage commun entre le chien et sa maîtresse, remplacé par l'affection qui se passe de toute verbalisation... mais malgré tout, je ne savais pas vraiment quoi en penser. A l'exception d'un passage vraiment réussi - la description des odeurs à Florence ! Dans le flux lénifiant de la narration, elle fait l'effet d'un feu d'artifice de l'imagination créative.
Assurément, la lecture devient bien plus captivante au moment où le trio central, les époux Browning avec Flush, arrive en Italie. Jusqu'ici le chien ne fait que rester allongé aux côtés d'Elizabeth malade dans les décors somptueux et moroses de la Wimpole Street londonienne. Les descriptions de l'intérieur font vraiment partie des qualités du roman, mais tout de même - elles remplissent la bonne moitié du livre ! Tandis qu'en Italie, le monde réel avec sa lumière, son mouvement et ses bruits, entre enfin dans la vie d'Elizabeth et de Flush.
J'admets aussi très volontiers que Virginia évoque l'atmosphère historique à la perfection. Londres de l'époque victorienne avec ses slums et ses voleurs de chiens, l'Italie révolutionnaire qui réclame une constitution (1848), spiritisme, romantisme avec sa fine fleur littéraire... bref, la moitié du 19ème siècle comme si on y était.
Dans ses journaux, la romancière décrit son épuisement extrême après avoir fini "Les Vagues", ses tension et ses appréhensions en attendant les réactions à ce livre, et elle dit que la rédaction de "Flush" était pour elle une façon de se reposer.
C'est écrit avec humour et légèreté, et cela se lit de la même manière. Virginia y valorise tout ce qu'elle a l'habitude de démanteler dans ses autres romans : l'inertie et le beau fixe de la société victorienne, avec toutes ses règles et ses impassibles coulisses. C'est sans doute la raison pour laquelle "Flush" se vendait aussi bien, à l'époque, et pourquoi il garde toujours son intérêt.
Mais je ne suis pas persuadée que de nos jours c'est une lecture transcendante pour les amateurs de Virginia Woolf... ni même pour les amateurs de chiens. La noblesse de race y est souvent thématisée, on touche à l'élevage, y compris à l'élimination de chiots dont le toupet ne correspond pas exactement aux standards exigés, et par moments ça m'a agacée.
Puis, en finissant la lecture dans un nuage de poils, la main entre les oreilles du chat, j'ai compris la véritable raison pourquoi "Flush" ne sera jamais en mesure de me convaincre complètement... d'où mes 3,5/5 très personnels.
[...] "Roses, gathered for a vase,
In that chamber died apace,
Beam and breeze resigning —
This dog only, waited on,
Knowing that when light is gone,
Love remains for shining." [...] (Elizabeth Barrett-Browning, "To Flush, My Dog")
(Groucho Marx)
Quand j'ai appris que Virginia Woolf avait écrit un petit roman biographique sur Elizabeth Barrett-Browning, raconté du point de vue de son cocker, je l'ai tout de suite classé mentalement dans la catégorie "décidément à lire". Et je suis relativement déçue... quoique, oui, dans certains cas ce livre peut s'avérer idéal. J'ai d'abord planifié que la lecture de "Flush" me permettra de procrastiner pendant mes travaux de rénovation domestique... finalement ce fut le contraire, et par conséquent j'ai achevé toutes mes bricoles beaucoup plus vite que prévu.
On trottera au pas de l'épagneul Flush, qui, encore tout jeune chien, arrive dans la luxueuse maison de la célèbre poétesse. Un cadeau de la modeste famille des Milford à leur chère mademoiselle Barrett, dont l'esprit si merveilleusement vif reste emprisonné dans un corps si regrettablement inerte. La peur et la langueur du jeune chiot vont se transformer peu à peu en amour inconditionnel entre Flush et sa nouvelle maîtresse. Flush va renoncer à sa liberté, aux lapins et aux galipettes à l'air libre, et tout cela rien que pour elle. Les choses se compliqueront quelque peu, quand Miss Barrett tombera amoureuse de Mr Browning...
Mon plus grand problème avec le livre se trouve dans la conception du protagoniste principal, coincée quelque part à mi-chemin entre l'anthropomorphisation et le portrait fidèle d'un animal. Virginia Woolf ne propose décidément pas une image réaliste de la mentalité canine, comme le fait, disons, Eric Knight dans "Lassie" (par exemple, en observant les occupations de sa maîtresse, Flush souhaite savoir écrire comme elle). le monde à travers les yeux noisette de l'épagneul reste cependant très différent du nôtre, ce qui réduit l'angle de vue du narrateur lié au personnage de Flush. le résultat est une pelote emmêlée d'observations qui ne sont ni tout à fait humaines, ni tout à fait canines. C'est pourtant un des points intéressants du récit : l'absence de langage commun entre le chien et sa maîtresse, remplacé par l'affection qui se passe de toute verbalisation... mais malgré tout, je ne savais pas vraiment quoi en penser. A l'exception d'un passage vraiment réussi - la description des odeurs à Florence ! Dans le flux lénifiant de la narration, elle fait l'effet d'un feu d'artifice de l'imagination créative.
Assurément, la lecture devient bien plus captivante au moment où le trio central, les époux Browning avec Flush, arrive en Italie. Jusqu'ici le chien ne fait que rester allongé aux côtés d'Elizabeth malade dans les décors somptueux et moroses de la Wimpole Street londonienne. Les descriptions de l'intérieur font vraiment partie des qualités du roman, mais tout de même - elles remplissent la bonne moitié du livre ! Tandis qu'en Italie, le monde réel avec sa lumière, son mouvement et ses bruits, entre enfin dans la vie d'Elizabeth et de Flush.
J'admets aussi très volontiers que Virginia évoque l'atmosphère historique à la perfection. Londres de l'époque victorienne avec ses slums et ses voleurs de chiens, l'Italie révolutionnaire qui réclame une constitution (1848), spiritisme, romantisme avec sa fine fleur littéraire... bref, la moitié du 19ème siècle comme si on y était.
Dans ses journaux, la romancière décrit son épuisement extrême après avoir fini "Les Vagues", ses tension et ses appréhensions en attendant les réactions à ce livre, et elle dit que la rédaction de "Flush" était pour elle une façon de se reposer.
C'est écrit avec humour et légèreté, et cela se lit de la même manière. Virginia y valorise tout ce qu'elle a l'habitude de démanteler dans ses autres romans : l'inertie et le beau fixe de la société victorienne, avec toutes ses règles et ses impassibles coulisses. C'est sans doute la raison pour laquelle "Flush" se vendait aussi bien, à l'époque, et pourquoi il garde toujours son intérêt.
Mais je ne suis pas persuadée que de nos jours c'est une lecture transcendante pour les amateurs de Virginia Woolf... ni même pour les amateurs de chiens. La noblesse de race y est souvent thématisée, on touche à l'élevage, y compris à l'élimination de chiots dont le toupet ne correspond pas exactement aux standards exigés, et par moments ça m'a agacée.
Puis, en finissant la lecture dans un nuage de poils, la main entre les oreilles du chat, j'ai compris la véritable raison pourquoi "Flush" ne sera jamais en mesure de me convaincre complètement... d'où mes 3,5/5 très personnels.
[...] "Roses, gathered for a vase,
In that chamber died apace,
Beam and breeze resigning —
This dog only, waited on,
Knowing that when light is gone,
Love remains for shining." [...] (Elizabeth Barrett-Browning, "To Flush, My Dog")
Un lieu à soi est la nouvelle traduction d'Une Chambre à soi par Marie Darrieussecq, qui a aussi rédigé une nouvelle préface. La notice et les notes sont de Christine Reynier, qui selon l'éditeur est : « l'une des meilleures spécialistes françaises de Woolf. » Son annotation permet d'élucider les nombreuses références de Woolf et retrace bien les différentes interprétations dont ce texte (fondé sur un ensemble de conférences sur les femmes et la littérature) a fait l'objet.
Dans cette remarquable analyse féministe Virginia Woolf établit avec ironie les causes du silence littéraire des femmes pendant de nombreuses décennies. Pour elle si les hommes sous-estiment et cantonnent les femmes dans des tâches subalternes c'est pour éviter de remettre en cause leur confiance en eux. Et comme les femmes qui n'ont pas accès aux études et ne sont pas autorisées à travailler sont dépendantes financièrement et intellectuellement, elles sont dans l'impossibilité de penser aux choses en elles-mêmes, donc d'écrire.
Heureusement au XIXe siècle des femmes ont bravé les interdits. Emily et Charlotte Brontë, George Eliot et surtout Jane Austen ont écrit, même si elles l'ont fait en cachette, sans chambre à elles pour s'isoler. Elles sont celles qui ont permis aux femmes d'accéder à la création littéraire. Des femmes qui par la suite ont acquis pour la plupart une indépendance financière grâce à leurs écrits. Et si Virginia Woolf montre parfaitement les contraintes au développement de l'oeuvre de ces auteurs dans une société patriarcale, elle précise aussi que " la littérature élisabéthaine aurait été très différente de ce qu'elle est si le féminisme avait pris naissance au XVIe siècle et non au XIXe."
Dans cette remarquable analyse féministe Virginia Woolf établit avec ironie les causes du silence littéraire des femmes pendant de nombreuses décennies. Pour elle si les hommes sous-estiment et cantonnent les femmes dans des tâches subalternes c'est pour éviter de remettre en cause leur confiance en eux. Et comme les femmes qui n'ont pas accès aux études et ne sont pas autorisées à travailler sont dépendantes financièrement et intellectuellement, elles sont dans l'impossibilité de penser aux choses en elles-mêmes, donc d'écrire.
Heureusement au XIXe siècle des femmes ont bravé les interdits. Emily et Charlotte Brontë, George Eliot et surtout Jane Austen ont écrit, même si elles l'ont fait en cachette, sans chambre à elles pour s'isoler. Elles sont celles qui ont permis aux femmes d'accéder à la création littéraire. Des femmes qui par la suite ont acquis pour la plupart une indépendance financière grâce à leurs écrits. Et si Virginia Woolf montre parfaitement les contraintes au développement de l'oeuvre de ces auteurs dans une société patriarcale, elle précise aussi que " la littérature élisabéthaine aurait été très différente de ce qu'elle est si le féminisme avait pris naissance au XVIe siècle et non au XIXe."
Original, éclectique, foisonnant voire délirant. Ce roman de Virginia Woolf est la fois imprégné de la patte littéraire de l'auteur et totalement atypique. S'il est classé comme une fantaisie, un intermède après une écriture épuisante (Promenade au phare), il est cependant lourd des obsessions que l'on connaît, et d'une incessante introspection que l'on ressent comme douloureuse. C'est dans la forme que réside la légèreté, pas dans le fond
Orlando est un personnage étonnant, homme puis femme, et qui parcourt quatre siècles de l'histoire de l'Angleterre sans prendre une ride. C'est l'occasion pour lui ou elle d'analyser le rôle social dévolu à chaque sexe et son évolution dans le temps, mais aussi l'impact des progrès technologiques sur la vie quotidienne.
C'est assez déroutant, puis quand on se laisse porter par le récit on effectue un magnifique voyage entre le rêve et la folie, dans le temps et l'espace, sans répit.
On retrouve bien entendu le style riche et sensuel, qui semble parfois émaner d'une écriture automatique, de divagations de la pensée comme ce qui peut se produire au cours de l'état de veille juste avant de s'endormir.
Ce n'est pas une lecture facile, mais cet exercice de style apporte une lumière intéressante sur l'ensemble de l'œuvre et sur la personnalité de cette femme hors du commun.
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Orlando est un personnage étonnant, homme puis femme, et qui parcourt quatre siècles de l'histoire de l'Angleterre sans prendre une ride. C'est l'occasion pour lui ou elle d'analyser le rôle social dévolu à chaque sexe et son évolution dans le temps, mais aussi l'impact des progrès technologiques sur la vie quotidienne.
C'est assez déroutant, puis quand on se laisse porter par le récit on effectue un magnifique voyage entre le rêve et la folie, dans le temps et l'espace, sans répit.
On retrouve bien entendu le style riche et sensuel, qui semble parfois émaner d'une écriture automatique, de divagations de la pensée comme ce qui peut se produire au cours de l'état de veille juste avant de s'endormir.
Ce n'est pas une lecture facile, mais cet exercice de style apporte une lumière intéressante sur l'ensemble de l'œuvre et sur la personnalité de cette femme hors du commun.
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à entrer dans ce magnifique récit qu'est Mrs Dalloway, et autant vous le dire tout de suite, j'ai eu un mal terrible à le quitter.
Pourtant il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire, presque rien, du moins sous l'angle de l'action. C'est l'histoire d'une femme qui sort de chez elle pour aller chercher des fleurs et qui pense à la soirée qu'elle donnera le soir-même.
Le roman nous raconte cette journée... En plus, elle est mondaine...! Dit comme cela, avouez que l'histoire paraît banale, anodine, superficielle presque.
Mais c'est ailleurs que les choses sont présentes...
Mrs Dalloway, c'est Clarissa Dalloway, une femme qui entre dans sa cinquante-deuxième année ; c'est jeune n'est-ce pas ? sauf qu'on est en 1923 et que Mrs Dalloway est une femme qui a blanchi prématurément à la suite d'une maladie. Elle est riche et mondaine, son mari est député conservateur à la Chambre des Communes. Nous sommes en juin 1923, c'est une période un peu étrange qui suit la première guerre mondiale, période autant emplie d'une joie de vivre frénétique que marquée encore par les traumatismes de la guerre, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Nous la suivons sur le déploiement d'une journée à Londres, au rythme des frémissements de la rue et des cloches de Big Ben. Ah ! Big Ben, parlons-en... Je crois qu'il ne sonne plus actuellement, mais disons que c'est presque un personnage à part entière du roman, rythmant la déambulation de Mrs Dalloway, ses émois pour ne pas dire ses vibrations, tel un métronome.
Car Mrs Dalloway est un sublime roman du temps.
Au début, je me suis laissé happer par Clarissa Dalloway dans le mouvement de la ville, les klaxons des autobus, j'ai eu plaisir à déambuler avec elle, quoique les femmes mondaines... mais bon... Je me suis laissé prendre la main par sa joie, il y avait en elle une sensation de vivre. Dans cette promenade urbaine, j'ai aimé reconnaître des noms qui me disaient quelque chose : Piccadilly Circus, Regent Parc, Saint-Paul, Green Street, Bedfort Place qui m'a amené jusqu'à Russel Square... Soudain c'est le carrosse royal qui quitte Buckingham Palace. Tout près nous sommes déjà à Westminster. Dans le ciel londonien, un aéroplane s'amuse dans un vol étrange à chercher à écrire des messages parmi les nuages...
Clarissa est au coeur de ce roman, le narrateur qui nous raconte cette chronique d'une journée comme une autre, lui cède de temps en temps le pas, lui donnant la parole, sous forme de confidences, pour que nous entrions peu à peu dans sa pensée et ses sensations, par petites touches ; si Mrs Dalloway était une peinture, ce serait une peinture impressionniste.
Je suis entré peu à peu dans le paysage intérieur de Mrs Dalloway et c'est là que le vrai voyage a commencé...
Tandis que Mrs Dalloway est une femme heureuse et déambule sur cette seule et unique journée, des événements se terrent à l'affût en arrière-plan : les regrets, le malheur, la guerre, la souffrance, la folie...
Et voilà que surgissent des fantômes du passé qui seront là ce soir. Un amoureux transi du passé, Peter Walsh qui revient des Indes, se met à pleurer à gros sanglots et cette fameuse Sally Seton qui avait de l'audace quand elle était jeune, elle courait nue dans les couloirs, elle avait donné un baiser sur la bouche de Clarissa qui en était tombée aussitôt amoureuse. Car ce fut peut-être le plus beau baiser qu'elle reçut dans sa vie. À travers les yeux de Clarissa Dalloway, nous voyons la tragédie du mariage, son naufrage... Et comment ne pas être ému par le personnage de Septimus Warren Smith, emporté dans sa folie ou plutôt la folie des hommes puisqu'il n'est jamais vraiment revenu de la guerre ? J'ai toujours la gorge serrée quand je lis la description d'un personnage suicidaire imaginé par un écrivain qui a quitté la vie de la même manière...
Ainsi se mêlent le temps extérieur et le temps intérieur, - ce discours intérieur si chère à Virginia Woolf que l'on désigne par les flux de conscience, au rythme des cloches de Big Ben qui arrime et sépare le passé du présent, le temps intérieur des bruits de la vie extérieure.
Oui Clarissa Dalloway est heureuse, je vous l'assure, en ce jour de juin 1923, mais son âme est comme « une forêt encombrée de feuilles ». le bonheur de Mrs Dalloway est une angoisse voilée d'élégance.
Tout remonte à la surface de ce bonheur en ce jour de juin 1923 : les ombres, les souvenirs, les regrets, la peur de vieillir, celle de mourir aussi.
J'ai aimé ce roman d'une très grande délicatesse. J'ai vu dans la manière qu'a Virginia Woolf de nous raconter une histoire, une sensibilité à savoir capter les nuances changeantes des sentiments et à nous les restituer dans la grandeur de la vie malgré ses apparences ordinaires.
Mrs Dalloway est ce roman à la fois bienfaisant et cruel qui peut nous donner le vertige de vouloir recommencer sa vie.
Lire Mrs Dalloway, C'est regarder le ciel, les nuages, l'herbe et les arbres, entendre le bruit d'une fontaine, le son d'un violon, se laisser distraire par le vol étrange d'un aéroplane...
C'est ouvrir de grandes fenêtres, contempler le ciel jusqu'au vertige et entrer dans un grand jardin, celui de nos vies intérieures.
J'y ai retrouvé la douce mélancolie d'un voyage ancien à Londres et puis une tout autre mélancolie, celle des paysages intérieurs pour lesquels Virginia Woolf sait nous entraîner comme au bord de l'abîme.
Pourtant il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire, presque rien, du moins sous l'angle de l'action. C'est l'histoire d'une femme qui sort de chez elle pour aller chercher des fleurs et qui pense à la soirée qu'elle donnera le soir-même.
Le roman nous raconte cette journée... En plus, elle est mondaine...! Dit comme cela, avouez que l'histoire paraît banale, anodine, superficielle presque.
Mais c'est ailleurs que les choses sont présentes...
Mrs Dalloway, c'est Clarissa Dalloway, une femme qui entre dans sa cinquante-deuxième année ; c'est jeune n'est-ce pas ? sauf qu'on est en 1923 et que Mrs Dalloway est une femme qui a blanchi prématurément à la suite d'une maladie. Elle est riche et mondaine, son mari est député conservateur à la Chambre des Communes. Nous sommes en juin 1923, c'est une période un peu étrange qui suit la première guerre mondiale, période autant emplie d'une joie de vivre frénétique que marquée encore par les traumatismes de la guerre, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Nous la suivons sur le déploiement d'une journée à Londres, au rythme des frémissements de la rue et des cloches de Big Ben. Ah ! Big Ben, parlons-en... Je crois qu'il ne sonne plus actuellement, mais disons que c'est presque un personnage à part entière du roman, rythmant la déambulation de Mrs Dalloway, ses émois pour ne pas dire ses vibrations, tel un métronome.
Car Mrs Dalloway est un sublime roman du temps.
Au début, je me suis laissé happer par Clarissa Dalloway dans le mouvement de la ville, les klaxons des autobus, j'ai eu plaisir à déambuler avec elle, quoique les femmes mondaines... mais bon... Je me suis laissé prendre la main par sa joie, il y avait en elle une sensation de vivre. Dans cette promenade urbaine, j'ai aimé reconnaître des noms qui me disaient quelque chose : Piccadilly Circus, Regent Parc, Saint-Paul, Green Street, Bedfort Place qui m'a amené jusqu'à Russel Square... Soudain c'est le carrosse royal qui quitte Buckingham Palace. Tout près nous sommes déjà à Westminster. Dans le ciel londonien, un aéroplane s'amuse dans un vol étrange à chercher à écrire des messages parmi les nuages...
Clarissa est au coeur de ce roman, le narrateur qui nous raconte cette chronique d'une journée comme une autre, lui cède de temps en temps le pas, lui donnant la parole, sous forme de confidences, pour que nous entrions peu à peu dans sa pensée et ses sensations, par petites touches ; si Mrs Dalloway était une peinture, ce serait une peinture impressionniste.
Je suis entré peu à peu dans le paysage intérieur de Mrs Dalloway et c'est là que le vrai voyage a commencé...
Tandis que Mrs Dalloway est une femme heureuse et déambule sur cette seule et unique journée, des événements se terrent à l'affût en arrière-plan : les regrets, le malheur, la guerre, la souffrance, la folie...
Et voilà que surgissent des fantômes du passé qui seront là ce soir. Un amoureux transi du passé, Peter Walsh qui revient des Indes, se met à pleurer à gros sanglots et cette fameuse Sally Seton qui avait de l'audace quand elle était jeune, elle courait nue dans les couloirs, elle avait donné un baiser sur la bouche de Clarissa qui en était tombée aussitôt amoureuse. Car ce fut peut-être le plus beau baiser qu'elle reçut dans sa vie. À travers les yeux de Clarissa Dalloway, nous voyons la tragédie du mariage, son naufrage... Et comment ne pas être ému par le personnage de Septimus Warren Smith, emporté dans sa folie ou plutôt la folie des hommes puisqu'il n'est jamais vraiment revenu de la guerre ? J'ai toujours la gorge serrée quand je lis la description d'un personnage suicidaire imaginé par un écrivain qui a quitté la vie de la même manière...
Ainsi se mêlent le temps extérieur et le temps intérieur, - ce discours intérieur si chère à Virginia Woolf que l'on désigne par les flux de conscience, au rythme des cloches de Big Ben qui arrime et sépare le passé du présent, le temps intérieur des bruits de la vie extérieure.
Oui Clarissa Dalloway est heureuse, je vous l'assure, en ce jour de juin 1923, mais son âme est comme « une forêt encombrée de feuilles ». le bonheur de Mrs Dalloway est une angoisse voilée d'élégance.
Tout remonte à la surface de ce bonheur en ce jour de juin 1923 : les ombres, les souvenirs, les regrets, la peur de vieillir, celle de mourir aussi.
J'ai aimé ce roman d'une très grande délicatesse. J'ai vu dans la manière qu'a Virginia Woolf de nous raconter une histoire, une sensibilité à savoir capter les nuances changeantes des sentiments et à nous les restituer dans la grandeur de la vie malgré ses apparences ordinaires.
Mrs Dalloway est ce roman à la fois bienfaisant et cruel qui peut nous donner le vertige de vouloir recommencer sa vie.
Lire Mrs Dalloway, C'est regarder le ciel, les nuages, l'herbe et les arbres, entendre le bruit d'une fontaine, le son d'un violon, se laisser distraire par le vol étrange d'un aéroplane...
C'est ouvrir de grandes fenêtres, contempler le ciel jusqu'au vertige et entrer dans un grand jardin, celui de nos vies intérieures.
J'y ai retrouvé la douce mélancolie d'un voyage ancien à Londres et puis une tout autre mélancolie, celle des paysages intérieurs pour lesquels Virginia Woolf sait nous entraîner comme au bord de l'abîme.
Quelle bonne surprise que cet essai! Pour tout dire, je l'ai choisi pour l'auteur et le titre, après un bref coup d'oeil à la quatrième de couverture pour en garder le plaisir de découverte, et j'ai goûté chaque page qui se tournait avec délice.
On y suit la narratrice - Virginia Woolf? Mary Beton, Seton? - qu'importe dit-elle, une femme anglaise qui écrit dans les années 30, s'interroger sur ce qui peut unir la littérature et les femmes. Quand je dis "on y suit", je parle bien sûr littéralement: dans le parc de l'université, avant qu'elle ne soit refoulée à l'entrée de la bibliothèque universitaire en tant que femme non accompagnée, puis au dîner - car "on ne peut ni bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir, si on n'a pas bien dîné" - et avec elle on observe ces passants par la fenêtre, prend un livre écrit par une femme sur les étagères, puis un autre, chaque nouvelle observation dirigeant le fil de la réflexion.. C'est ainsi que se déroule le récit, puisque la narratrice tient à nous expliquer le cheminement de sa pensée jusqu'à cette "chambre à soi".
Pourquoi y a-t 'il eu si peu, voire pas du tout, de femmes écrivains jusqu'au 18ème siècle? Virginia Woolf nomme bien sûr le peu de liberté accordée aux femmes jusqu'à il y a peu, leur dépendance financière, leur manque d'instruction, la nécessité de garder leur vertu, leur réclusion dans la maison, et les considérations masculines - disons plutôt leur manque de considération pour celles qui tentent d'être autre chose que des mères - tous ces aspects en défaveur des femmes créatrices, des femmes intellectuelles.
En vraie anglaise, Virginia Woolf aborde toutes ces discriminations qui ont enfermé ou rejeté les femmes avec humour et ironie, et la lecture de cet essai est un délice tout comme une source de réflexion sur la femme mais aussi la littérature de manière plus générale. On y découvre son admiration pour la liberté que s'autorisaient Shakespeare et Jane Austen, chassant négligemment contraintes et critiques pour écrire des oeuvres géniales. Et puis, en filigrane, se révèle ce qui incita V. Woolf à écrire Mrs Dalloway tel qu'elle l'a fait, ou à choisir un Orlando homme et femme.
Alors finalement, pourquoi ce titre, "une Chambre à soi"? Je vous laisse le plaisir de le découvrir!
On y suit la narratrice - Virginia Woolf? Mary Beton, Seton? - qu'importe dit-elle, une femme anglaise qui écrit dans les années 30, s'interroger sur ce qui peut unir la littérature et les femmes. Quand je dis "on y suit", je parle bien sûr littéralement: dans le parc de l'université, avant qu'elle ne soit refoulée à l'entrée de la bibliothèque universitaire en tant que femme non accompagnée, puis au dîner - car "on ne peut ni bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir, si on n'a pas bien dîné" - et avec elle on observe ces passants par la fenêtre, prend un livre écrit par une femme sur les étagères, puis un autre, chaque nouvelle observation dirigeant le fil de la réflexion.. C'est ainsi que se déroule le récit, puisque la narratrice tient à nous expliquer le cheminement de sa pensée jusqu'à cette "chambre à soi".
Pourquoi y a-t 'il eu si peu, voire pas du tout, de femmes écrivains jusqu'au 18ème siècle? Virginia Woolf nomme bien sûr le peu de liberté accordée aux femmes jusqu'à il y a peu, leur dépendance financière, leur manque d'instruction, la nécessité de garder leur vertu, leur réclusion dans la maison, et les considérations masculines - disons plutôt leur manque de considération pour celles qui tentent d'être autre chose que des mères - tous ces aspects en défaveur des femmes créatrices, des femmes intellectuelles.
En vraie anglaise, Virginia Woolf aborde toutes ces discriminations qui ont enfermé ou rejeté les femmes avec humour et ironie, et la lecture de cet essai est un délice tout comme une source de réflexion sur la femme mais aussi la littérature de manière plus générale. On y découvre son admiration pour la liberté que s'autorisaient Shakespeare et Jane Austen, chassant négligemment contraintes et critiques pour écrire des oeuvres géniales. Et puis, en filigrane, se révèle ce qui incita V. Woolf à écrire Mrs Dalloway tel qu'elle l'a fait, ou à choisir un Orlando homme et femme.
Alors finalement, pourquoi ce titre, "une Chambre à soi"? Je vous laisse le plaisir de le découvrir!
Voulant découvrir l'art de cette grande dame des lettres, j'ai commencé par ce livre. A vrai dire je ne savais absolument pas dans quel terrain je m'aventurer. Et ainsi , j'ai plongé dans cette promenade au phare.
Ce livre s'inscrit dans une lignée de romans célèbres à savoir "A la recherche du temps perdu", "Ulysse", "Carnets de Malte Laurids Brigge" ... Des romans où l'introspection prime et où l'intrigue est secondaire (mais aussi la rareté des dialogues).
Certes, parfois la lecture est très lente (10 pages de ce roman correspondent à plus de 50 pages d'un roman d'aventures). Mais à maintes fois, je me suis arrêté pour dire :" Mon Dieu cela est vrai!" ou "Mon Dieu que cela est magnifique". Woolf a réussi à mener à bout ces monologues internes qui se déroulent dans l'inaction des personnages comme commentaires à des faits ou dires ou pensées parfois refoulées. Ces personnages qui sont comme seuls au milieu des autres. Chacun est une unité à part (me rappelant la fameuse idée de Baudelaire, de trouver sa solitude au milieu de la foule et de se tenir compagnie dans sa solitude; idée qu'on trouve dans son Spleen de Paris); dans son propre monde. Mais l'unité de ces gens est Mrs Ramsay, l'âme tendre, magnanime et prévenante (sans être pour autant l'héroïne de ce roman sans héros). Par ailleurs, Woolf, loin des aventures époustouflantes, nous présente les tâches quotidiennes aussi simples (qui interrompent les réflexions et les pensées) comme des faits fort intéressants (une capacité singulière). Un roman sur l'influence des événements de l'enfance sur la personnalité de l'individu, sur la vie éphémère, sur le mariage, la maternité,...
Un roman qui mérite cette peine qu'il nous exige.
Ce livre s'inscrit dans une lignée de romans célèbres à savoir "A la recherche du temps perdu", "Ulysse", "Carnets de Malte Laurids Brigge" ... Des romans où l'introspection prime et où l'intrigue est secondaire (mais aussi la rareté des dialogues).
Certes, parfois la lecture est très lente (10 pages de ce roman correspondent à plus de 50 pages d'un roman d'aventures). Mais à maintes fois, je me suis arrêté pour dire :" Mon Dieu cela est vrai!" ou "Mon Dieu que cela est magnifique". Woolf a réussi à mener à bout ces monologues internes qui se déroulent dans l'inaction des personnages comme commentaires à des faits ou dires ou pensées parfois refoulées. Ces personnages qui sont comme seuls au milieu des autres. Chacun est une unité à part (me rappelant la fameuse idée de Baudelaire, de trouver sa solitude au milieu de la foule et de se tenir compagnie dans sa solitude; idée qu'on trouve dans son Spleen de Paris); dans son propre monde. Mais l'unité de ces gens est Mrs Ramsay, l'âme tendre, magnanime et prévenante (sans être pour autant l'héroïne de ce roman sans héros). Par ailleurs, Woolf, loin des aventures époustouflantes, nous présente les tâches quotidiennes aussi simples (qui interrompent les réflexions et les pensées) comme des faits fort intéressants (une capacité singulière). Un roman sur l'influence des événements de l'enfance sur la personnalité de l'individu, sur la vie éphémère, sur le mariage, la maternité,...
Un roman qui mérite cette peine qu'il nous exige.
La lecture de Mrs Dalloway mérite qu'une fois le livre refermé, on s'accorde un temps de repos, de réflexion, histoire de mettre un peu d'ordre dans ce feu d'artifice d'impressions, de sensations, de mieux percevoir les principaux personnages qui se détachent de ce théâtre d'ombre et de lumière. Personnages d'une grande complexité : Mrs Dalloway, membre de la haute-bourgeoisie londonienne, Peter Walsh, son ancien amoureux revenu des Indes, Septimus, rescapé de la Première guerre mondiale, en train de sombrer dans la folie. En arrière-fond, des personnages qui ne font que passer : Sally Selton, une amie ; l'époux de Mrs Dalloway, Richard ; sa fille Elisabeth et bien d'autres encore.
Mais derrière ce désordre apparent, se cache paradoxalement, un ordre rigoureux avec une unité de lieu : Londres ; une unité de temps, une journée, rythmée par les horloges de la ville, notamment Big Ben. Et l'auteure joue avec tout cela. Elle nous invite tour à tour à suivre les déambulations de ses personnages en nous donnant à voir le spectacle de la vie londonienne, à toutes les heures de la journée, tout en plongeant avec une fluidité d'écriture extraordinaire dans leurs pensées les plus intimes.
Ce qui m'a frappé dans cette longue balade londonienne, c'est la multiplicité des regards, celui de Clarissa et de Peter et bien d'autres encore, ce qui donne à chaque détail perçu une coloration différente. Autre élément remarquable, l'art de saisir l'instant dans sa richesse et sa diversité sur le plan sonore et visuel. le roman fourmille de ces petits tableaux impressionnistes qui permettent de voir, d'entendre, de sentir, le bruissement ou le foisonnement de la vie quotidienne dans ce qu'elle a à la fois de plus banal et en même temps de plus précieux. Saisir l'instant présent dans son étonnante diversité mais aussi suspendre le temps, le distordre, pour mieux s'attarder sur un spectacle éphémère est un autre aspect du talent de l'auteure. Cela donne lieu à de très beaux "arrêts sur images" comme lorsqu'elle évoque des nuages dans le ciel, un mystérieux carrosse près de Westminster ou un avion dans le ciel. de très belles évocations qui déclenchent l'imaginaire de tous ceux qui regardent et le nôtre.
Cet art quasiment cinématographique de la description laisse souvent la place à celui du monologue intérieur chez les trois principaux personnages. Je dois avouer que ce qui m'a le plus intéressée n'est pas la relation amoureuse qui a existé ou existe encore entre Peter et Clarissa. Ce n'est pas, à mes yeux du moins, la partie la plus réussie. Ce qui m'a passionnée c'est d'analyser quel rapport ces trois personnages entretenaient avec l'auteure dont on connaît la mort tragique.
Ce qui frappe chez Clarissa, c'est la fragmentation du moi : d'un côté la grande bourgeoise, très à l'aise dans son rôle social, de l'autre un moi intime beaucoup plus torturé, partagé entre la célébration du moment présent et le doute sur soi-même. Comment ne pas percevoir dans cette dichotomie l'écho des troubles bipolaires dont Virginia Woolf a souffert toute sa vie... Très intéressant également est le regard qu'elle porte sur Peter Walsh, un double très critique dont elle redoute le jugement. Ce qui, à mes yeux, fait ,également de ce dernier personnage un double littéraire de l'auteure. Celui de son personnage social surtout, car c'est lui qui porte un regard sarcastique impitoyable sur la gentry londonienne, société que connaît bien Virginia Woolf. La série de portraits délicieusement "méchants" qu'il brosse lors de la réception de Clarissa, est à ce titre un vrai régal !
Et quid du troisième personnage, Septimus ? J'avoue que c'est celui auquel j'ai le moins accroché, même si ses délires visuels et sonores étaient déjà ceux de Virginia Woolf. Et l'évocation de son suicide m'a paru plus relever d'une interrogation métaphysique que d'une angoisse existentielle. le souvenir que je garderai de Mrs Dalloway est donc celui d'un personnage plus tourmenté que tragique.
Je terminerai cette chronique en soulignant combien l'écriture de ce roman m'a séduite et permis de dépasser la complexité de sa construction.
Mais derrière ce désordre apparent, se cache paradoxalement, un ordre rigoureux avec une unité de lieu : Londres ; une unité de temps, une journée, rythmée par les horloges de la ville, notamment Big Ben. Et l'auteure joue avec tout cela. Elle nous invite tour à tour à suivre les déambulations de ses personnages en nous donnant à voir le spectacle de la vie londonienne, à toutes les heures de la journée, tout en plongeant avec une fluidité d'écriture extraordinaire dans leurs pensées les plus intimes.
Ce qui m'a frappé dans cette longue balade londonienne, c'est la multiplicité des regards, celui de Clarissa et de Peter et bien d'autres encore, ce qui donne à chaque détail perçu une coloration différente. Autre élément remarquable, l'art de saisir l'instant dans sa richesse et sa diversité sur le plan sonore et visuel. le roman fourmille de ces petits tableaux impressionnistes qui permettent de voir, d'entendre, de sentir, le bruissement ou le foisonnement de la vie quotidienne dans ce qu'elle a à la fois de plus banal et en même temps de plus précieux. Saisir l'instant présent dans son étonnante diversité mais aussi suspendre le temps, le distordre, pour mieux s'attarder sur un spectacle éphémère est un autre aspect du talent de l'auteure. Cela donne lieu à de très beaux "arrêts sur images" comme lorsqu'elle évoque des nuages dans le ciel, un mystérieux carrosse près de Westminster ou un avion dans le ciel. de très belles évocations qui déclenchent l'imaginaire de tous ceux qui regardent et le nôtre.
Cet art quasiment cinématographique de la description laisse souvent la place à celui du monologue intérieur chez les trois principaux personnages. Je dois avouer que ce qui m'a le plus intéressée n'est pas la relation amoureuse qui a existé ou existe encore entre Peter et Clarissa. Ce n'est pas, à mes yeux du moins, la partie la plus réussie. Ce qui m'a passionnée c'est d'analyser quel rapport ces trois personnages entretenaient avec l'auteure dont on connaît la mort tragique.
Ce qui frappe chez Clarissa, c'est la fragmentation du moi : d'un côté la grande bourgeoise, très à l'aise dans son rôle social, de l'autre un moi intime beaucoup plus torturé, partagé entre la célébration du moment présent et le doute sur soi-même. Comment ne pas percevoir dans cette dichotomie l'écho des troubles bipolaires dont Virginia Woolf a souffert toute sa vie... Très intéressant également est le regard qu'elle porte sur Peter Walsh, un double très critique dont elle redoute le jugement. Ce qui, à mes yeux, fait ,également de ce dernier personnage un double littéraire de l'auteure. Celui de son personnage social surtout, car c'est lui qui porte un regard sarcastique impitoyable sur la gentry londonienne, société que connaît bien Virginia Woolf. La série de portraits délicieusement "méchants" qu'il brosse lors de la réception de Clarissa, est à ce titre un vrai régal !
Et quid du troisième personnage, Septimus ? J'avoue que c'est celui auquel j'ai le moins accroché, même si ses délires visuels et sonores étaient déjà ceux de Virginia Woolf. Et l'évocation de son suicide m'a paru plus relever d'une interrogation métaphysique que d'une angoisse existentielle. le souvenir que je garderai de Mrs Dalloway est donc celui d'un personnage plus tourmenté que tragique.
Je terminerai cette chronique en soulignant combien l'écriture de ce roman m'a séduite et permis de dépasser la complexité de sa construction.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Virginia Woolf
Lecteurs de Virginia Woolf Voir plus
Quiz
Voir plus
Virginia Woolf
Virginia Woolf a grandi dans une famille que nous qualifierions de :
classique
monoparentale
recomposée
10 questions
199 lecteurs ont répondu
Thème :
Virginia WoolfCréer un quiz sur cet auteur199 lecteurs ont répondu