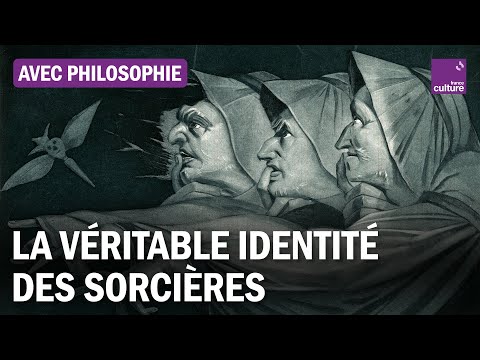Né(e) à : Calgary (Canada) , 1968
Martin Rueff, né en 1968 à Calgary (Canada), est un traducteur, poète et philosophe français.
Ajouter des informations
Les femmes qui usaient des baguettes et potions, lançant des sorts et effrayant les enfants, ont-elles vraiment existé ? L'histoire a trop souvent fait des femmes l'objet d'accusations arbitraires de sorcellerie. Mais qui étaient réellement les "sorcières" derrière ces critiques ? Dans le premier épisode de la série "Ce que cachent les sorcières", issu de l'émission "Avec philosophie", Géraldine Muhlmann se penche sur la véritable identité des sorcières. Elle reçoit : Armelle le Bras-Chopard, professeur émérite de science politique à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Martin Rueff, professeur de littérature française à l'Université de Genève Vignette de la miniature : Getty / Keith Lance #philosophie #sorcière #histoire Pour en savoir plus : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/les-sorcieres-dans-l-histoire-realite-ou-realite-fantasmatique-9409949 Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
3.
pleurez doux alcyons pleurez
ils crient ils tombent ils sont au sein des flots
et nulle Thétis n’a le soin de les cacher
nulle troupe n’a le cœur de les pleurer
et la mer argentée leur sert de couverture
et le ciel étoilé est en eux
et la mort au-dessus d’eux
au-dessus de leurs corps emportés seuls
dont l’amer fait peau neuve
Faire de ce geste un symbole de la liberté d’expression,
n’est-ce pas confondre ici deux sens du mot langue : la langue
comme organe et la langue comme capacité de s’exprimer? La
langue qui est dans ma bouche et la langue comme moyen de
formuler mes pensées et de les communiquer ou de les taire ?
Loin de confondre ces deux significations, on demande ce que
permet de penser le fait que, dans plusieurs des langues que
nous connaissons, mais non pas toutes, ce soit le même mot
qui en vienne à désigner l’organe et la capacité. Il faudra bien,
pour les penser ensemble, commencer par les distinguer.
…
p.15
Ce sont surtout les enfants qui tirent la langue. Ils le font
parfois en avançant la tête et en se concentrant avec un air
qu’on dit buté. Je voudrais donc rendre hommage à la langue et
en particulier à la langue des enfants, tendue comme un poing,
un défi, une insurrection : une petite protrusion pour dire non.
Qu’Albert Einstein, un des plus grands savants du xxe siècle,
ait tiré la langue sur une photographie célèbre contribue, tout
autant que sa chevelure blanche toujours décoiffée, à l’image
de liberté enfantine qui s’attache à ce grand génie. L’anecdote
est bien connue. L’image a été prise le 14 mars 1951. Einstein a
72 ans; on vient de fêter son anniversaire à l’Institut d’études
avancées de Princeton; il s’engouffre dans une voiture. Un
photographe le poursuit et lui demande de sourire. Einstein
regarde l’appareil photo et tire la langue en écarquillant les
yeux comme pour embêter le journaliste — « la lingua stretta
coi denti ». C’est un peu comme s’il disait « non, j’en ai assez,
fichez-moi la paix ». Mais l’agence de presse diffuse l’image
et Einstein l’accepte. Un jour il enverra cette photographie
accompagnée de quelques lignes : « Vous aimerez ce geste,
parce qu’il est destiné à toute l’humanité. Un civil peut se
permettre de faire ce qu’aucun diplomate n’oserait ».
…
p.13/14
C’est dans cette dernière partie de son œuvre que j’ai
trouvé ce souvenir, même si j’ai conscience qu’il me faudrait
relier ce que je vais dire à l’anthropologie politique de Masse et
puissance. Canetti est né en 1905 en Bulgarie sur la rive sud du
Danube dans une famille de Juifs séfarades où il parlait le ladino
mais, comme il le fait remarquer, là où il habitait « on pouvait
entendre parler sept ou huit langues dans la journée. Hormis
les Bulgares […], il y avait beaucoup de Turcs […] et, juste à
côté, le quartier des Séfarades espagnols, le nôtre. On rencon-
trait des Grecs, des Albanais, des Arméniens, des Tziganes.
Les Roumains venaient de l’autre côté du Danube […]. Il y
avait aussi des Russes, peu nombreux il est vrai ». En 1911 le
petit Elias suit ses parents en Angleterre, puis, à la mort de son
père, il entre à l’école en Autriche. Pour le préparer, sa mère
l’emmène à Lausanne quelques mois pendant l’été. C’est là
qu’il apprendra l’allemand qui n’est pas sa langue maternelle,
mais une langue que lui a inculquée sa mère.
La Langue sauvée (en allemand, Die gerettete Zunge) est
le premier volume de l’autobiographie d’Elias Canetti. Il le
publie en 1977. Il a soixante-douze ans. Le livre commence
par un chapitre intitulé « Mon premier souvenir ».
…
p.16
11.
je cherche une phrase
qui se marie à une autre
épousailles sposalizio
thalassogame je dis
oui à l’eau, au fleuve
à la Jonction qui roule
dans les deux sens
le passé par-dessus
le futur en dessous
sotto sotto sto bene
sotto sotto sto bene
en courants alternés
le présent
c’est un nuage beigeâtre
parmi les anémones du langage
sous la surface
qui s’étiole
en charpie dans le courant
bleu et sprofonda in me
quelques passants saluent
du pont quand Claude
aux Pâquis sauve le
manuscrit de la Jonction, hourra
Trattenerti, volessi anche, non posso
la Jonction noie sourciers et cibilistes
à la surface en étrange water-polo
perché sì le parole sono importanti
Au bout de la langue on veut enfin penser que le poème fait ce que nulle autre forme de langage ne fait – il le fait parce qu’il est le seul à le faire et qu’il est seul à faire ensemble ce qu’il est seul à faire : il inscrit au défaut de la voix (il ne performe rien que l’écart de l’écrit dans la voix et de la voix dans l’écrit) ; il nomme au défaut de la présence et mécontente Hegel ; il articule où le vers déroute la phrase ; il invite à la rencontre de l’adresse impossible et de l’ouverture du sens. Ces quatre actes de la parole poétique ont deux conséquences : le poème désassujettit et dés-attache. Il dénoue en organisant sa perte continuée les attachements du sujet à sa voix, à son monde, à son phrasé intime, à son présent, à son identité. Il ne performe pas – il préforme. C’est ce qu’il fait. C’est l’intensité généreuse de son action restreinte. C’est pourquoi aussi le poème tient bien plus qu’il ne promet. Lui demander davantage serait aussi vain que déplacé.
Au bout
de la langue, il y a là une revendication de la liberté civile, de
faire comprendre qu’on dit « non » avec la langue — « donc
c’est non » écrivait le poète Henri Michaux, et cette revendica-
tion, loin de se draper dans une dignité qui prendrait la pose,
s’affiche en tirant la langue. Un monde où l’on ne pourrait
plus tirer la langue serait un monde plus triste et plus inquié-
tant, où la liberté d’expression serait vraiment menacée. On
peut regretter que l’image offerte par quelqu’un qui tire la
langue ait pu constituer progressivement une image attendue
de la provocation — au point de s’afficher sur des pochettes de
disque ou sur des tee-shirts, mais qui dira les puissances de la
récupération ?
…
p.14
Ce que le masque avait fait disparaître en cachant nos
visages, c’étaient les sourires, les baisers esquissés en avançant
les lèvres et l’éclat des dents, le menton aussi — la bouche
surtout. Ce dont il nous privait, c’était d’un geste, un des rares
que nous fassions avec la bouche ou plutôt, avec la bouche et
la langue, de l’intérieur de la bouche avec la langue. Tirer la
langue, il semble que tous les peuples le fassent, et les enfants
de tous les peuples surtout, quand bien même on n’accorderait
pas la même signification à ce geste, et c’en était un pour l’an-
thropologue Marcel Jousse. Tirer la langue avec un masque,
c’est peine perdue, à moins de vouloir faire ressembler le bas
de notre visage à une tente de camping tendue par un piquet.
…
p.13
Quiz sur l´Etranger par Albert Camus
L´Etranger s´ouvre sur cet incipit célèbre : "Aujourd´hui maman est morte...
4804 lecteurs ont répondu