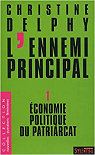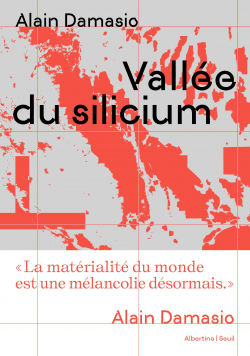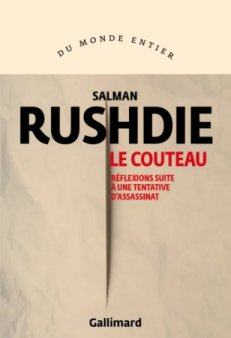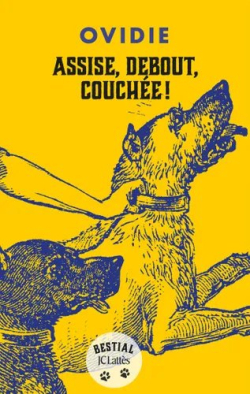Enseignement 2016-2017 : de la littérature comme sport de combat
Titre : Introduction
Chaire du professeur Antoine Compagnon : Littérature française moderne et contemporaine : histoire, critique, théorie (2005-2020)
Cours du 3 janvier 2017.
Retrouvez les vidéos de ses enseignements :
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon
Le cours de cette année répond à celui de 2014 qui portait sur la « guerre littéraire » de 1914-1918, c'est-à-dire sur l'inscription de la réalité de la guerre dans les oeuvres, et sur les différentes postures, souvent paradoxalement pacifiques, que l'expérience de la guerre a prescrites aux écrivains. Il s'agira cette année au contraire d'envisager la production littéraire comme lieu d'une conflictualité sui generis, tantôt sur le mode d'une détermination au combat d'idées, tantôt sur le mode d'une compétition pour la survie au sein de ce que Pierre Bourdieu, dans Les Règles de l'art, a décrit comme le « champ » littéraire. Il s'agit aussi de faire un sort à une figure rencontrée dans le cours de 2016 : celle du crochet de l'écrivain chiffonnier, mise en place par Baudelaire, et qui pouvait toujours se retourner en arme. À partir de Baudelaire et en remontant dans la modernité littéraire, on découvre une généalogie d'images : la plume-épée des Dialogues et entretiens philosophiques De Voltaire, ou la plume de fer par laquelle, bien avant l'apparition de l'objet industriel lui-même, Ronsard décrit son ambition de défense d'une France royale et catholique, dans la Continuation du Discours des misères de ce temps (1563).
La création littéraire se définit régulièrement par comparaison avec les sports de combat, et même plus généralement avec le sport, en tant que le sport a rapport au combat, c'est-à-dire à la compétition. Il y a, chez elle aussi, des championnats, des prix, la possibilité d'un dopage. Tout jeune écrivain, avertit Fontenelle, doit se préparer à entrer en lice ; Maurice Barrès lui-même, qui s'est beaucoup tenu à distance des accidents de la camaraderie littéraire, a l'impression de rejoindre un « match professionnel » au moment de rendre compte de son exploration de l'Égypte. Tous les grands écrivains du XIXe siècle, à peu d'exceptions près, se sont battus en duel, comme si ce moment de duel révélait la valeur agonistique latente de la littérature. La littérature, plutôt ou autant qu'au loisir (otium), n'aurait-elle pas rapport au negotium, au remue-ménage ? La pacification, la consolation comptent parmi ses opérations possibles, mais leur inverse paraît une tendance constitutive de la création et de l'existence littéraire.
L'abbé Irail, dans ses Querelles littéraires (1761), s'intéressait à la figure d'Archiloque, tout à la fois premier poète lyrique et premier poète satirique, qui fait de la poésie avec sa colère et son désir de vengeance. le génie et la querelle sont liés : il n'y a pas eu de siècle de grand talent, observe-t-il, qui ne fût un siècle de grande agitation et de grande jalousie entre les écrivains. Comme dans la théorie économique de Bernard Mandeville, il semble que, dans les arts, les vices privés servent le bien général et que le florissement d'une culture repose sur la querelle permanente de ses représentants.
Notre rapport à la littérature reconnaît implicitement une telle dimension pugilistique, proprement romantique ; c'est la règle du winner takes all. Pierre Bourdieu et Harold Bloom ont été les théoriciens de cette difficulté de survivre en littérature, et de cette dynamique réelle de la littérature, bien différente d'un glissement naturel d'âges, qui fait se heurter d'une part les gloires littéraires acquises, pour qui l'urgence est de durer, d'autre part les aspirants à la gloire, qui savent qu'ils n'acquerront le droit de durer qu'en rejetant leurs prédécesseurs dans le passé.
Sportifs, escrimeurs, prisonniers : ce sont plusieurs figures, au sens de Roland Barthes, de cette agonistique motrice de la vie littéraire entre la Restauration et le Second Empire, qui seront envisagées tout au long du cours.
Découvrez toutes les ressources du Collège de France :
https://www.college-de-france.fr
Suivez-nous sur :
Facebook : https://ww

Pierre BourdieuRichard Figuier/5
3 notes
Résumé :
Donner à (re)lire à plus de quarante ans de distance l'Esquisse d'une théorie de la pratique n'a pas pour but essentiel de rendre disponibles des textes devenus introuvables d'un auteur connu. Plus profondément, il s'agit de pénétrer avec un regard neuf dans la forge de l'ethnologue et du sociologue, dans cet atelier, inscrit à jamais dans l'histoire de la décolonisation algérienne, où se sont élaborés les concepts majeurs d'une théorie du monde social qui tente tou... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Esquisse d'une théorie de la pratique : Précédé de Trois études d'ethnologie kabyleVoir plus
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Le mariage avec la cousine parallèle patrilinéaire (bent'amm, la fille du frère du père), ne peut apparaître “comme une sorte de scandale”, selon les termes de Claude Lévi-Strauss, que pour les esprits structurés conformément aux catégories de pensée qu'il déconcerte. Cette sorte de quasi-inceste légitime oppose un redoutable défi tant aux théories des groupes d'unifiliation qu'à la théorie de l'alliance de mariage : en effet, à travers la notion d’exogamie, qui est la condition de la reproduction de lignées séparées et de la permanence et de l'identification aisée des unités consécutives, il met en question la notion d'unifiliation (unilineal descent), c'est-à-dire la possibilité de définir le statut d'un individu en fonction du statut de ses ascendants, paternel ou maternel, et de l'un des deux seulement, en même temps que la théorie du mariage comme échange d'une femme contre une femme, supposant le tabou de l'inceste, c'est-à-dire l'impératif de l'échange. Tandis que la règle d'exogamie distingue nettement des groupes d'alliance et des groupes de filiation qui, par définition, ne peuvent coïncider, la lignée généalogique se trouvant du même coup définie de façon claire, puisque les pouvoirs, les privilèges et les devoirs se transmettent soit en ligne maternelle, soit en ligne paternelle, l'endogamie a pour effet d'effacer la distinction entre les lignées.
L'intérieur de la maison kabyle présente la forme d'un rectangle qu'un petit mur à claire-voie s'élevant à mi-hauteur divise, au tiers de sa longueur, en deux parties : la plus grande, exhaussée de 50 cm environ et recouverte d'un enduit d'argile noire et de bouse de vache que les femmes polissent avec un galet, est réservée aux humains, la plus étroite, pavée de dalles, étant occupée par les bêtes. Une porte à deux battants donne accès aux deux pièces. Sur la murette de séparation sont rangés d'un côté les petites jarres de terre ou les paniers d'alfa dans lesquels on conserve les provisions destinées à la consommation immédiate-figues, farines, légumineuses-, de l'autre, près de la porte, les jarres d'eau. Au-dessus de l'écurie, se trouve une soupente où sont accumulés, à côté d'ustensiles de toute sorte, la paille et le foin destinés à la nourriture des animaux, et où dorment le plus souvent les femmes et les enfants, surtout en hiver. Devant la construction maçonnée et percée de niches et de trous, qui est adossée au mur de pignon, appelé mur (ou, plus exactement, “côté”) du haut ou du kanun, et qui sert au rangement des ustensiles de cuisine (louche, marmite, plat à cuire la galette et autres objets de terre cuite noircis par le feu) et de part et d'autre de laquelle sont placées de grandes jarres emplies de grain, se trouve le foyer, cavité circulaire de quelques centimètres de profondeur à son centre autour de laquelle trois grosses pierres destinées à recevoir les ustensiles de cuisine sont disposées en triangle.
N... avait toujours mangé à sa faim, il avait fait travailler les autres pour lui, il avait bénéficié, comme par un droit de seigneur, de tout ce que les autres avaient de meilleur dans leurs champs et dans leurs maisons ; bien que sa situation eût beaucoup décliné, il se croyait tout permis, il se sentait le droit de tout exiger, de s'attribuer seul la parole, d'insulter et même de battre ceux qui lui résistaient, Sans doute est-ce pour cela qu'on le tenait pour un amahbul. Amahbul, c'est l'individu éhonté et effronté qui outrepasse les limites de la bienséance garante des bonnes relations, c'est celui qui abuse d'un pouvoir arbitraire et commet des actes contraires à ce qu'enseigne l'art de vivre. Ces imahbal (pluriel de amahbul), on les fuit parce qu'on n'aime pas avoir une contestation avec eux, parce qu'ils sont à l'abri de la honte, parce que celui qui s'affronterait à eux serait en tous les cas la victime, même s'il se trouvait avoir raison.
Notre homme avait dans son jardin un mur à reconstruire. Son voisin avait un mur de soutènement. Il jette ce mur à bas et transporte chez lui la pierre. Cet acte arbitraire ne s'exerçait pas, cette fois, contre un plus faible, la “victime” avait les moyens, et largement, de se défendre. C'était un homme jeune, fort, comptant beaucoup de frères et de parents, appartenant à une famille nombreuse et puissante. Il était donc évident que s'il ne relevait pas le défi, ce n'était pas par crainte. Par suite, l'opinion publique ne pouvait voir dans cet acte abusif un véritable défi, portant atteinte à l'honneur (...)
Notre homme avait dans son jardin un mur à reconstruire. Son voisin avait un mur de soutènement. Il jette ce mur à bas et transporte chez lui la pierre. Cet acte arbitraire ne s'exerçait pas, cette fois, contre un plus faible, la “victime” avait les moyens, et largement, de se défendre. C'était un homme jeune, fort, comptant beaucoup de frères et de parents, appartenant à une famille nombreuse et puissante. Il était donc évident que s'il ne relevait pas le défi, ce n'était pas par crainte. Par suite, l'opinion publique ne pouvait voir dans cet acte abusif un véritable défi, portant atteinte à l'honneur (...)
Videos de Pierre Bourdieu (56)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : sociologieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Bourdieu (64)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelques questions sur Pierre Bourdieu
En quelle année était-il né ?
1920
1930
1940
1950
7 questions
42 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre BourdieuCréer un quiz sur ce livre42 lecteurs ont répondu