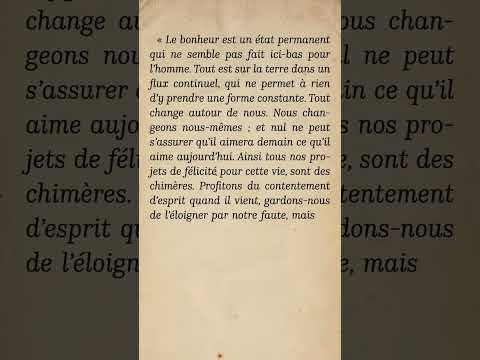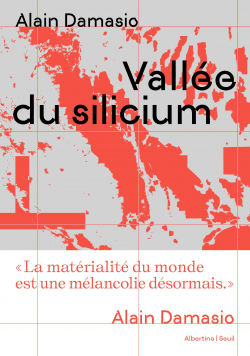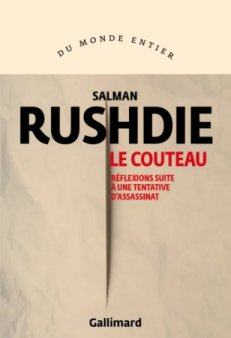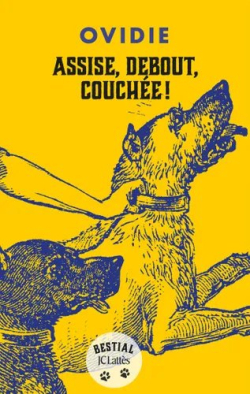*RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE* :
« Neuvième promenade », _in Les confessions de J.-J. Rousseau,_ suivies des _Rêveries du promeneur solitaire,_ tome second, Genève, s. é., 1783, pp. 373-374.
#JeanJacquesRousseau #RêveriesDuPromeneurSolitaire #Pensée

Jean-Jacques Rousseau
Jean Starobinski (Éditeur scientifique)/5 34 notes
Jean Starobinski (Éditeur scientifique)/5 34 notes
Résumé :
L'Essai sur l'origine des languesannonce déjà Saussure : nombre d'hypothèses formulées par Rousseau feront la fortune du structuralisme. Pourtant, ce texte inspiré tranche par son style avec l'aridité de la méthode linguistique.Si parfois d'ailleurs la prose de Rousseau paraît plus chantée qu'écrite, c'est qu'il tente de restituer au langage sa fonction primitive d'expression du désir et de l'émotion. Les hommes parlèrent d'abord la langue des poètes et non celle de... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Essai sur l'origine des languesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Un essai court et peu connue de JJ Rousseau. Cet humaniste s'intéressa à ce qui fait le sel des relations humaines, la langue.
Il pose en termes simples mais argumentés, illustrés de nombreuses références à l'histoire ancienne, toutes les questions que l'on peut se poser si l'on réfléchit un court instant au mystère, au miracle, à la magie de la langue.
En gros cela revient à se poser des questions basiques, pourquoi les Anglais parlent-ils ainsi, et les Allemands comme cela, alors que les Français le font autrement, et comment peuvent-ils arriver à communiquer ?
Pourquoi les Grecs écrivent-ils en caractères cyrilliques alors que les esquimaux dessinent des formes grossières ?
Remontant aux origines de l'humanité, Rousseau fait preuve de bon sens philosophique, de réalisme, d'acuité intellectuelle, en passant au scanner de son esprit toutes les causes qui peuvent influer sur l'apparition d'un langage, qui différencie les hommes des animaux, puis différencie les hommes selon le lieu géographique où ils vivent, le climat qu'ils subissent, le degré d'évolution de leur société.
Le besoin de communiquer est induit par ces différents paramètres. Rousseau définit de façon fort astucieuse que la langue nait du degré et de la complexité des relations sociales, et qu'elle s'accompagne, se transforme, au gré de leur évolution en des formes plus ou moins mélodieuses, permettant d'exprimer des sentiments plus ou moins complexes, des écritures aux graphies frustes ou sophistiquées, de la musique, des dessins, toutes formes de communication attachées au langage..
Une étude agréable à lire, à faire lire, pour démontrer que la réflexion pure conduit à la raison pure, celle qui traverse les siècles et nous fait parfois défaut aujourd'hui, empêtrés que nous sommes dans des schémas de raisonnement absurdes et artificiels.
Il pose en termes simples mais argumentés, illustrés de nombreuses références à l'histoire ancienne, toutes les questions que l'on peut se poser si l'on réfléchit un court instant au mystère, au miracle, à la magie de la langue.
En gros cela revient à se poser des questions basiques, pourquoi les Anglais parlent-ils ainsi, et les Allemands comme cela, alors que les Français le font autrement, et comment peuvent-ils arriver à communiquer ?
Pourquoi les Grecs écrivent-ils en caractères cyrilliques alors que les esquimaux dessinent des formes grossières ?
Remontant aux origines de l'humanité, Rousseau fait preuve de bon sens philosophique, de réalisme, d'acuité intellectuelle, en passant au scanner de son esprit toutes les causes qui peuvent influer sur l'apparition d'un langage, qui différencie les hommes des animaux, puis différencie les hommes selon le lieu géographique où ils vivent, le climat qu'ils subissent, le degré d'évolution de leur société.
Le besoin de communiquer est induit par ces différents paramètres. Rousseau définit de façon fort astucieuse que la langue nait du degré et de la complexité des relations sociales, et qu'elle s'accompagne, se transforme, au gré de leur évolution en des formes plus ou moins mélodieuses, permettant d'exprimer des sentiments plus ou moins complexes, des écritures aux graphies frustes ou sophistiquées, de la musique, des dessins, toutes formes de communication attachées au langage..
Une étude agréable à lire, à faire lire, pour démontrer que la réflexion pure conduit à la raison pure, celle qui traverse les siècles et nous fait parfois défaut aujourd'hui, empêtrés que nous sommes dans des schémas de raisonnement absurdes et artificiels.
Défi ABC 2023 2024 : Lettre R.
Défi non fiction 2024
Le sens figuré, dit Rousseau, a précédé le propre, la poésie la prose, et la passion la raison. le langage chez Rousseau se fait sensuel, sensitif, sensible, et sa dense prose expose son origine. A vrai dire, on ne peut le lire avec une mentalité de 2024, car scientifiquement parlant, la méthode de Rousseau consiste à affirmer des choses pourtant spéculatives (et on peut lui faire le même reproche avec l'état de nature, même si on peut aussi le lire métaphoriquement). Rousseau nous campe ainsi un âge d'or où la langue était imprécise mais véhiculait plus d'émotions. Prenant en compte les langues (plutôt que le langage), il distingue les cultures entre elles dans une forme de relativisme, non sans essentialisme hélas, d'autant qu'il adhère à une théorie en vogue à l'époque, celle des climats. Et le peuple le plus sauvage est... les Inuits ! (appelés eskimaux)
L'origine même du langage, qu'expliquent plusieurs mythes https://blog.assimil.com/mythes-et-origine-du-langage/ (j'apprécie beaucoup le mythe salish) et théories, est une question qui traditionnellement "ne se pose pas" en sciences du langage. (Saussure interdisait même à ses étudiants de consacrer leurs thèses à ce sujet). Cela dit, il est un peu facile de dire d'un texte du dix huitième qu'il n'est pas scientifique.
On trouve chez Rousseau de belles choses, comme la question de la prosodie et de l'harmonie, ou celle de l'oralité. Ainsi, l'effet de la lecture du livre le Coran ne sera pas le même que l'écoute d'une récitation du même texte, ce qui, selon lui, a permis de fonder la religion musulmane. Rousseau, en décentrant du seul Occident, tente de comprendre l'humanité. Il recentre la langue sur la passion, sa cause, plutôt que les besoins, et évoque joliment le feu familial comme origine de l'émotion. Il se fait ethnologue (de comptoir hélas) lorsqu'il écrit sur la musique, qui est davantage qu'une combinaison de sons "faisant joli", mais est imitation. Et puis, Rousseau réfute la synesthésie, et préfère la musique (humaine et donc sensible) à la peinture (purement naturelle). Ce type de débat me rappelle le Paragone (comparaison en italien), au cours de la Renaissance italienne, où l'on cherchait le meilleur des arts.
Pas de spoil/divulgâchage en non fiction, malgré tout j'ai été surprise par la fin, d'ordre politique. Rousseau m'a été sympathique tout du long de l'ouvrage (lu en un jour), et aborde des thèmes qui m'intéressent (les cultures du monde, la musique, le langage). Pourtant, hélas pour cet écrivain et philosophe, il n'a pas trop su me convaincre ici. Un ouvrage pas si connu pour son auteur, à étudier certes, mais davantage pour son intérêt en histoire de la philo ou des mentalités.
Défi non fiction 2024
Le sens figuré, dit Rousseau, a précédé le propre, la poésie la prose, et la passion la raison. le langage chez Rousseau se fait sensuel, sensitif, sensible, et sa dense prose expose son origine. A vrai dire, on ne peut le lire avec une mentalité de 2024, car scientifiquement parlant, la méthode de Rousseau consiste à affirmer des choses pourtant spéculatives (et on peut lui faire le même reproche avec l'état de nature, même si on peut aussi le lire métaphoriquement). Rousseau nous campe ainsi un âge d'or où la langue était imprécise mais véhiculait plus d'émotions. Prenant en compte les langues (plutôt que le langage), il distingue les cultures entre elles dans une forme de relativisme, non sans essentialisme hélas, d'autant qu'il adhère à une théorie en vogue à l'époque, celle des climats. Et le peuple le plus sauvage est... les Inuits ! (appelés eskimaux)
L'origine même du langage, qu'expliquent plusieurs mythes https://blog.assimil.com/mythes-et-origine-du-langage/ (j'apprécie beaucoup le mythe salish) et théories, est une question qui traditionnellement "ne se pose pas" en sciences du langage. (Saussure interdisait même à ses étudiants de consacrer leurs thèses à ce sujet). Cela dit, il est un peu facile de dire d'un texte du dix huitième qu'il n'est pas scientifique.
On trouve chez Rousseau de belles choses, comme la question de la prosodie et de l'harmonie, ou celle de l'oralité. Ainsi, l'effet de la lecture du livre le Coran ne sera pas le même que l'écoute d'une récitation du même texte, ce qui, selon lui, a permis de fonder la religion musulmane. Rousseau, en décentrant du seul Occident, tente de comprendre l'humanité. Il recentre la langue sur la passion, sa cause, plutôt que les besoins, et évoque joliment le feu familial comme origine de l'émotion. Il se fait ethnologue (de comptoir hélas) lorsqu'il écrit sur la musique, qui est davantage qu'une combinaison de sons "faisant joli", mais est imitation. Et puis, Rousseau réfute la synesthésie, et préfère la musique (humaine et donc sensible) à la peinture (purement naturelle). Ce type de débat me rappelle le Paragone (comparaison en italien), au cours de la Renaissance italienne, où l'on cherchait le meilleur des arts.
Pas de spoil/divulgâchage en non fiction, malgré tout j'ai été surprise par la fin, d'ordre politique. Rousseau m'a été sympathique tout du long de l'ouvrage (lu en un jour), et aborde des thèmes qui m'intéressent (les cultures du monde, la musique, le langage). Pourtant, hélas pour cet écrivain et philosophe, il n'a pas trop su me convaincre ici. Un ouvrage pas si connu pour son auteur, à étudier certes, mais davantage pour son intérêt en histoire de la philo ou des mentalités.
Ce livre permet en quelques pages de mieux comprendre la pensée de Rousseau concernant la nature de l'humain. J'ai apprécié les diverses réflexions qui permettent de penser la langue comme la partie de la culture la plus importante en vue de sa nécessité.
Citations et extraits (27)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans ce siècle où l'on s'efforce de matérialiser toutes les opérations de l'âme et d'ôter toute moralité aux sentiments humains, je suis trompé si la nouvelle philosophie ne devient pas aussi funeste au bon goût qu'à la vertu.
L'homme en société cherche à s'étendre, l'homme isolé se resserre.
Les premiers hommes furent chasseurs et non pas laboureurs.
Les premiers biens furent des troupeaux et non pas des champs.
Les premiers biens furent des troupeaux et non pas des champs.
LA parole distingue l'homme entre les animaux : le langage distingue les
nations entre elles ; on ne connaît d'où est un homme qu'après qu'il a parlé.
L'usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de son pays ; mais
qu'est-ce qui fait que cette langue est celle de son pays et non pas d'un autre ?
Il faut bien remonter, pour le dire, à quelque raison qui tienne au local, et qui
soit antérieure aux mœurs mêmes : la parole, étant la première institution
sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles.
..............
Ainsi l'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles. Il n'y a personne qui
ne sente la vérité du jugement d'Horace à cet égard. On voit même que les
discours les plus éloquens sont ceux où l'on enchâsse le plus d'images ; et les
sons n'ont jamais plus d'énergie que quand ils font l'effet des couleurs.
.....................
De cela seul il suit avec évidence que l'origine des langues n'est point due
aux premiers besoins des hommes ; il serait absurde que de la cause qui les
écarte vînt le moyen qui les unit. D'où peut donc venir cette origine ? Des
besoins moraux, des passions. Toutes les passions rapprochent les hommes
que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim, ni la
soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère, qui leur ont arraché les premières voix.
.......................
L'image illusoire offerte par la passion se
montrant la première, le langage qui lui répondait fut aussi le premier inventé ;
il devint ensuite métaphorique quand l'esprit éclairé, reconnaissant sa
première erreur, n'en employa les expressions que dans les mêmes passions qui l'avaient produite.
.........................
Un autre moyen de comparer les langues et de juger de leur ancienneté se
tire de l'écriture, et cela en raison inverse de la perfection de cet art. Plus
l'écriture est grossière, plus la langue est antique.
.........................
Pour savoir l'anglais, il faut l'apprendre deux fois ; l'une à le lire, et l'autre
à le parler. Si un Anglais lit à haute voix, et qu'un étranger jette les yeux sur le
livre, l'étranger n'aperçoit aucun rapport entre ce qu'il voit et ce qu'il entend.
Pourquoi cela ? parce que l'Angleterre ayant été successivement conquise par
divers peuples, les mots se sont toujours écrits de même, tandis que la manière de les prononcer a souvent changé.
.......................
Avec les premières voix se formèrent les premières articulations ou les
premiers sons, selon le genre de la passion qui dictait les uns ou les autres. La
colère arrache des cris menaçans, que la langue et le palais articulent : mais la
voix de la tendresse est plus douce, c'est la glotte qui la modifie, et cette voix
devient un son ; seulement les accens en sont plus fréquens ou plus rares, les
inflexions plus ou moins aiguës, selon le sentiment qui s'y joint. Ainsi la
cadence et les sons naissent avec les syllabes : la passion fait parler tous les
organes, et pare la voix de tout leur éclat ; ainsi les vers, les chants, la parole,
ont une origine commune.
......................................
Comme donc la peinture n'est pas l'art de combiner des couleurs d'une
manière agréable à la vue, la musique n'est pas non plus l'art de combiner des
sons d'une manière agréable à l'oreille. S'il n'y avait que cela, l'une et l'autre
seraient au nombre des sciences naturelles et non pas des beaux-arts. C'est
l'imitation seule qui les élève à ce rang. Or, qu'est-ce qui fait de la peinture un
art d'imitation ? c'est le dessin. Qu'est-ce qui de la musique en fait un autre ?
C'est la mélodie.
..........................
Je finirai ces réflexions superficielles, mais qui peuvent en faire naître de
plus profondes, par le passage qui me les a suggérées.
Ce serait la matière d'un examen assez philosophique, que d'observer
dans le fait, et de montrer par des exemples, combien le caractère, les mœurs
et les intérêts d'un peuple influent sur sa langue
nations entre elles ; on ne connaît d'où est un homme qu'après qu'il a parlé.
L'usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de son pays ; mais
qu'est-ce qui fait que cette langue est celle de son pays et non pas d'un autre ?
Il faut bien remonter, pour le dire, à quelque raison qui tienne au local, et qui
soit antérieure aux mœurs mêmes : la parole, étant la première institution
sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles.
..............
Ainsi l'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles. Il n'y a personne qui
ne sente la vérité du jugement d'Horace à cet égard. On voit même que les
discours les plus éloquens sont ceux où l'on enchâsse le plus d'images ; et les
sons n'ont jamais plus d'énergie que quand ils font l'effet des couleurs.
.....................
De cela seul il suit avec évidence que l'origine des langues n'est point due
aux premiers besoins des hommes ; il serait absurde que de la cause qui les
écarte vînt le moyen qui les unit. D'où peut donc venir cette origine ? Des
besoins moraux, des passions. Toutes les passions rapprochent les hommes
que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim, ni la
soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère, qui leur ont arraché les premières voix.
.......................
L'image illusoire offerte par la passion se
montrant la première, le langage qui lui répondait fut aussi le premier inventé ;
il devint ensuite métaphorique quand l'esprit éclairé, reconnaissant sa
première erreur, n'en employa les expressions que dans les mêmes passions qui l'avaient produite.
.........................
Un autre moyen de comparer les langues et de juger de leur ancienneté se
tire de l'écriture, et cela en raison inverse de la perfection de cet art. Plus
l'écriture est grossière, plus la langue est antique.
.........................
Pour savoir l'anglais, il faut l'apprendre deux fois ; l'une à le lire, et l'autre
à le parler. Si un Anglais lit à haute voix, et qu'un étranger jette les yeux sur le
livre, l'étranger n'aperçoit aucun rapport entre ce qu'il voit et ce qu'il entend.
Pourquoi cela ? parce que l'Angleterre ayant été successivement conquise par
divers peuples, les mots se sont toujours écrits de même, tandis que la manière de les prononcer a souvent changé.
.......................
Avec les premières voix se formèrent les premières articulations ou les
premiers sons, selon le genre de la passion qui dictait les uns ou les autres. La
colère arrache des cris menaçans, que la langue et le palais articulent : mais la
voix de la tendresse est plus douce, c'est la glotte qui la modifie, et cette voix
devient un son ; seulement les accens en sont plus fréquens ou plus rares, les
inflexions plus ou moins aiguës, selon le sentiment qui s'y joint. Ainsi la
cadence et les sons naissent avec les syllabes : la passion fait parler tous les
organes, et pare la voix de tout leur éclat ; ainsi les vers, les chants, la parole,
ont une origine commune.
......................................
Comme donc la peinture n'est pas l'art de combiner des couleurs d'une
manière agréable à la vue, la musique n'est pas non plus l'art de combiner des
sons d'une manière agréable à l'oreille. S'il n'y avait que cela, l'une et l'autre
seraient au nombre des sciences naturelles et non pas des beaux-arts. C'est
l'imitation seule qui les élève à ce rang. Or, qu'est-ce qui fait de la peinture un
art d'imitation ? c'est le dessin. Qu'est-ce qui de la musique en fait un autre ?
C'est la mélodie.
..........................
Je finirai ces réflexions superficielles, mais qui peuvent en faire naître de
plus profondes, par le passage qui me les a suggérées.
Ce serait la matière d'un examen assez philosophique, que d'observer
dans le fait, et de montrer par des exemples, combien le caractère, les mœurs
et les intérêts d'un peuple influent sur sa langue
J'ai dit ailleurs pourquoi les malheurs feints nous touchent bien plus que les véritables. Tel sanglote à la tragédie qui n'eût de ses jours pitié d'aucun malheureux. L'invention du Théâtre est admirable pour énorgueillir notre amour-propre de toutes les vertus que nous n'avons point.]
Videos de Jean-Jacques Rousseau (33)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Linguistique historiqueVoir plus
>Linguistique>Dialectologie. Linguistique historique (diachronique)>Linguistique historique (8)
autres livres classés : Musique et littératureVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Amoureux des langues
gavarneur
23 livres

Langues, un défi babélien
Alzie
17 livres
Autres livres de Jean-Jacques Rousseau (125)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1091 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1091 lecteurs ont répondu